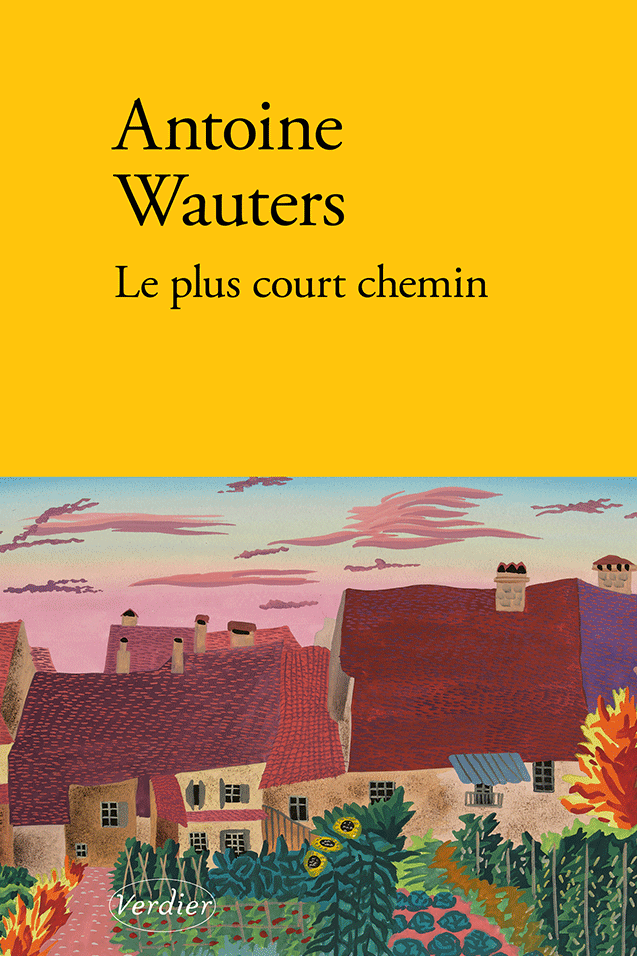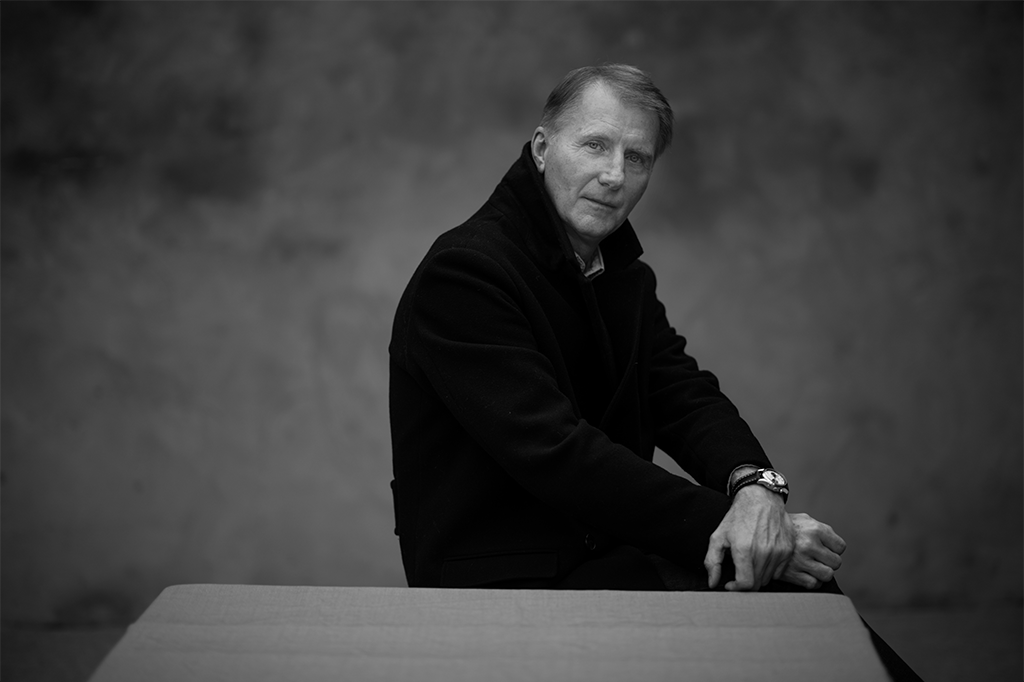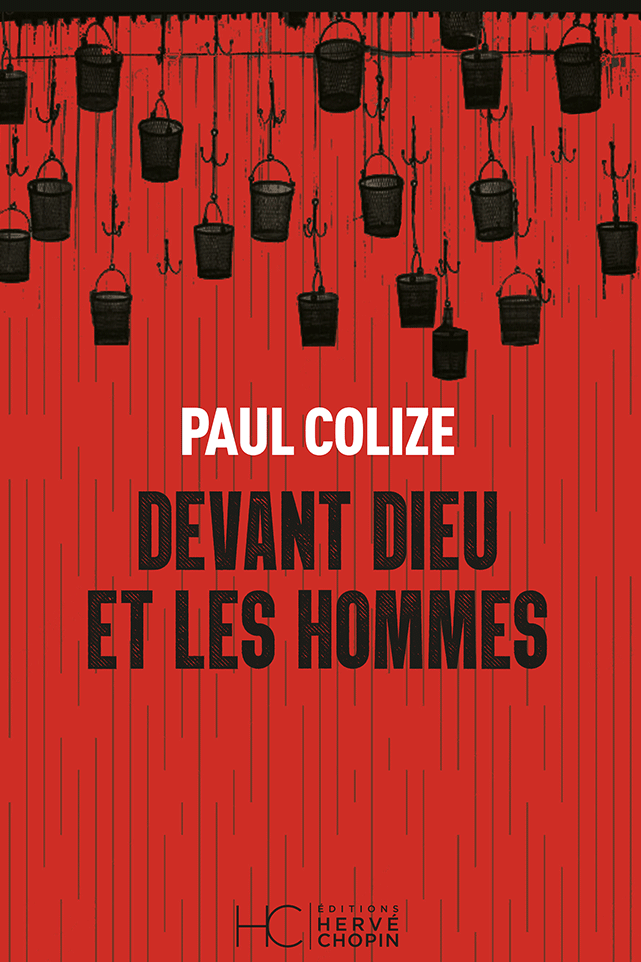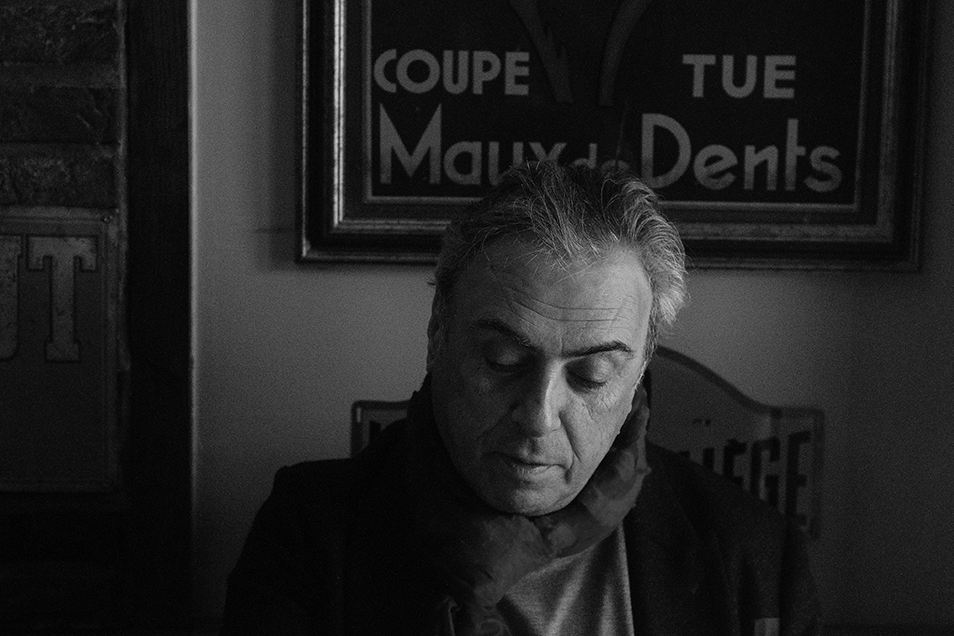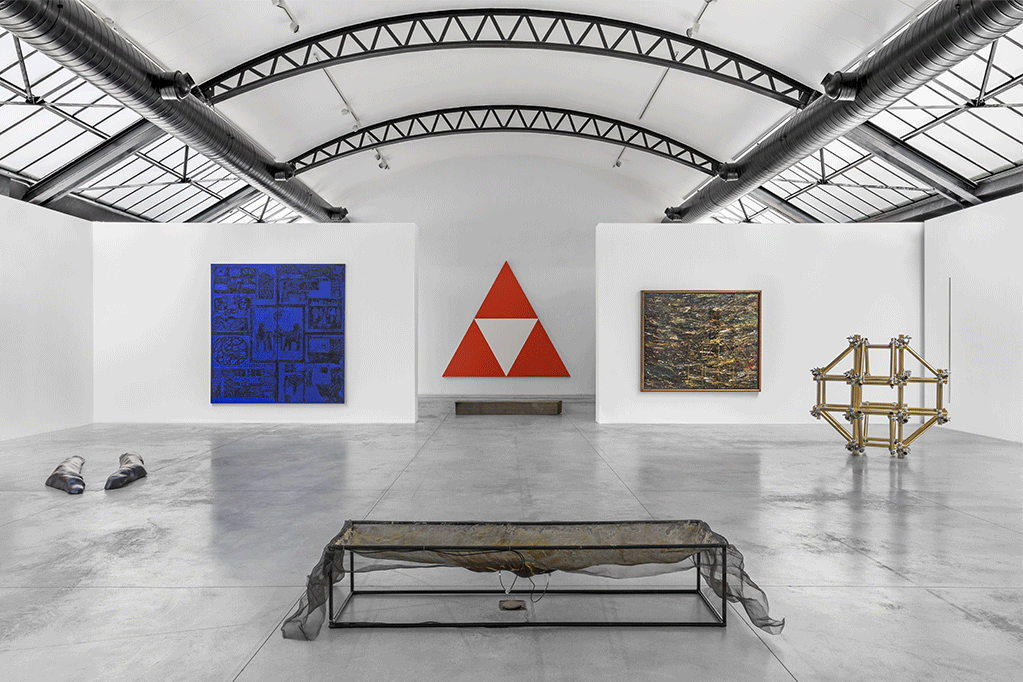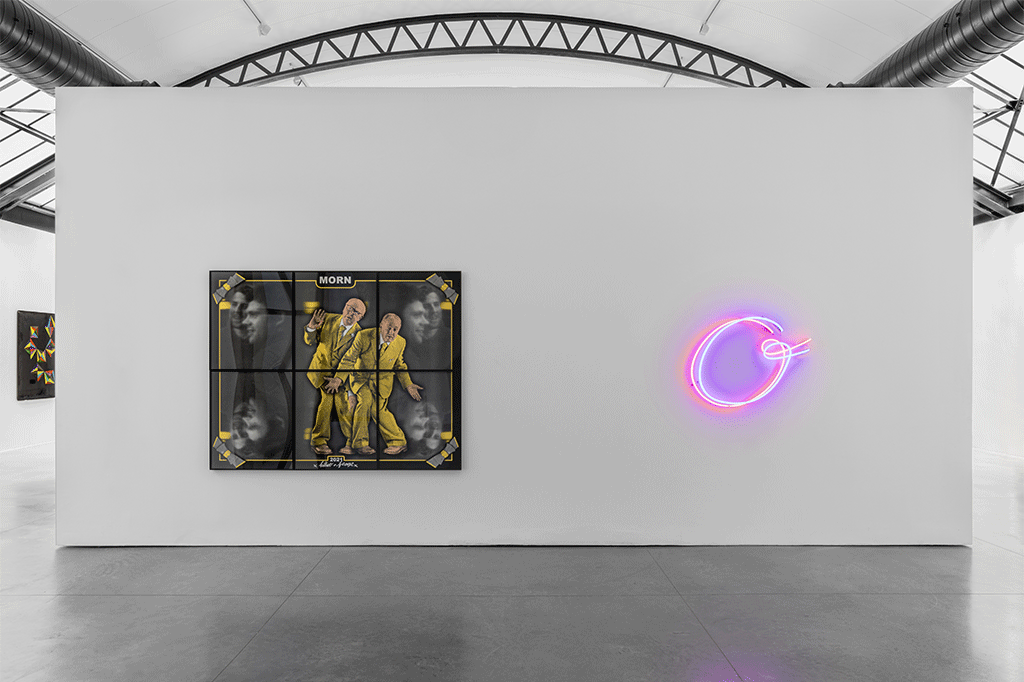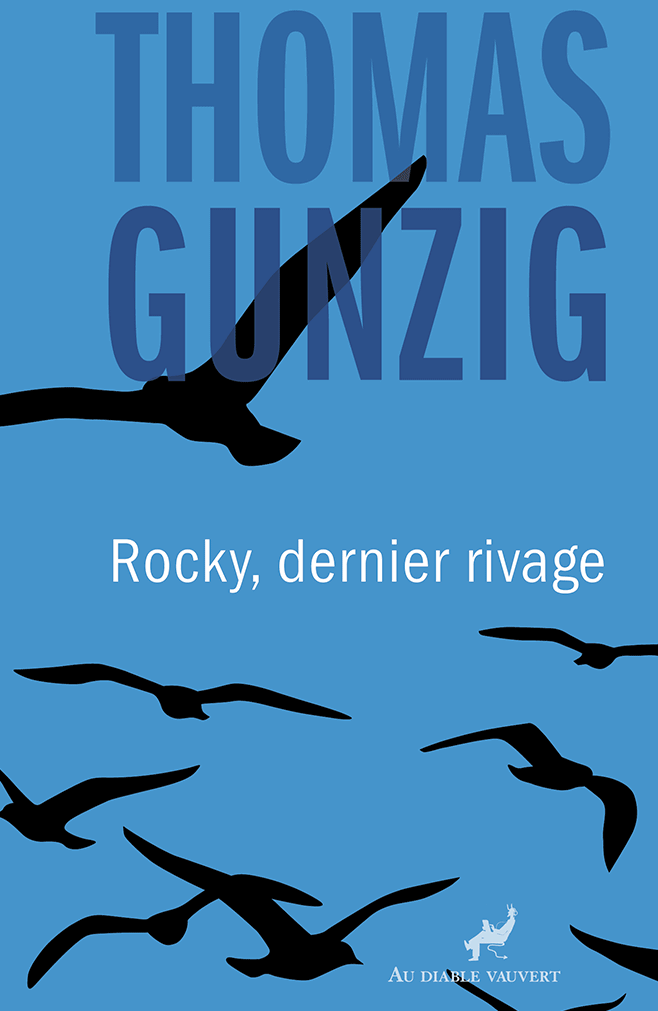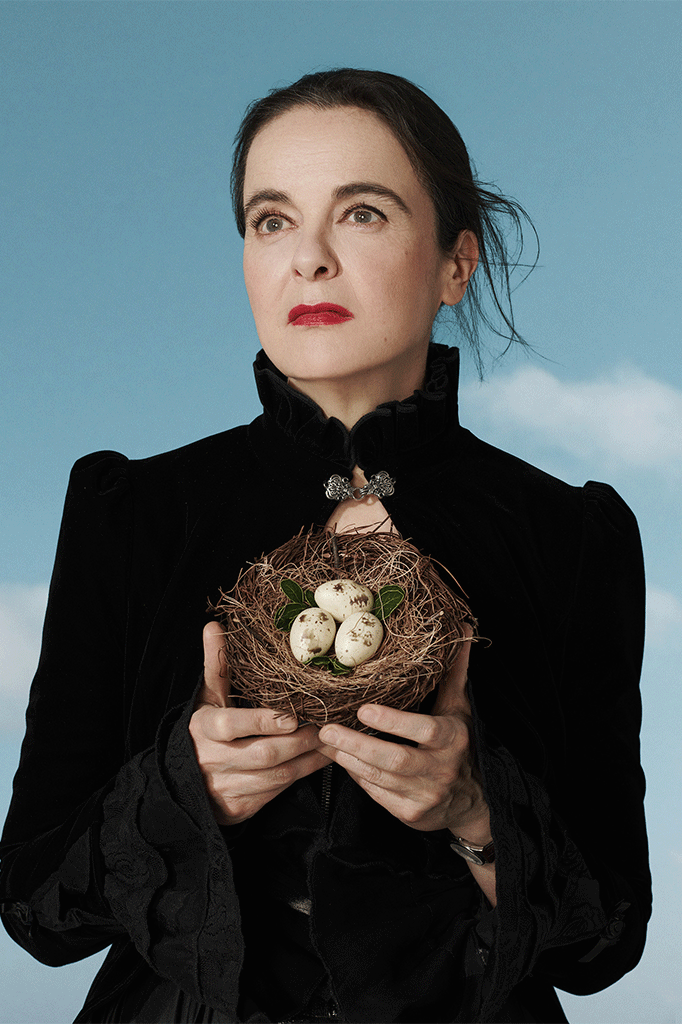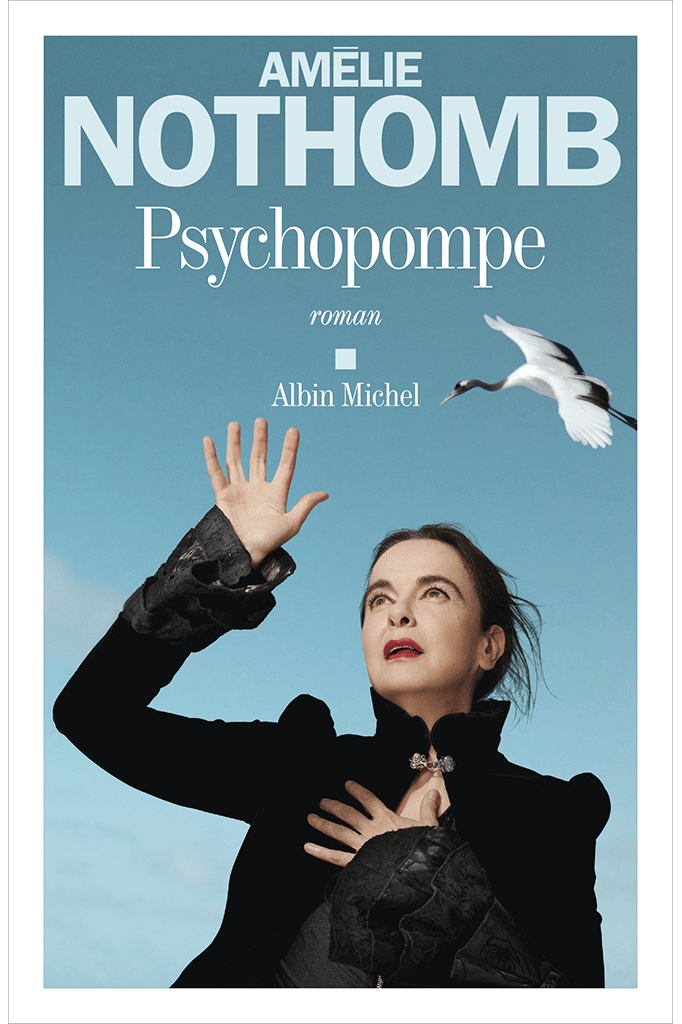ANTOINE WAUTERS : «Tout vient de là»
ANTOINE WAUTERS
«Tout vient de là»
MOTS : SERVANE CALMANT
PHOTO : LORRAINE WAUTERS
L’écrivain ardennais Antoine Wauters plonge dans ses souvenirs d’enfance, évoquant par petites touches, par fragments, à la façon des polaroïds, son village wallon, sa découverte de l’écriture, et les années 80 où l’on n’était pas obligé de se mettre en avant … « Tout vient de là » rythme avec une nostalgie agissante son précieux nouveau roman, « Le plus court chemin ».
Vous écrivez en page 117 que vous n’aimez pas faire la promo de vos livres. De quoi va-t-on parler ? (Rire) C’est une boutade.
Vraiment ? En partie. Ecrire est un exercice très intime et très solitaire. Quand on assure la promotion d’un livre, on s’éloigne inévitablement du travail d’écriture, de ce territoire silencieux.
Il y a un an, vous recevez le Goncourt de la nouvelle pour « Le Musée des contradictions » et une flopée de prix pour « Mahmoud ou la montée des eaux ». 2022 a dû changer votre vie ! Jusque-là, je rencontrais un succès d’estime, avec des livres qui se vendaient à quelques milliers d’exemplaires. « Mahmoud ou la montée des eaux » est en cours de traduction dans 15 pays… Mais je n’écris pas des livres qui ont pour finalité de remporter des prix, même si recevoir le Goncourt reste terriblement gratifiant.
Avec « Le plus court chemin », vous remontez le fil d’argent de votre propre enfance. Vous vous racontez, vous vous livrez. Mais quelle est la part de l’intime et la part romancée dans ce pan d’histoire ? Mon nouveau roman est basé sur des souvenirs, sur des témoignages, sur des lettres de mes parents, sur de longues déambulations dans ce village de Fraiture qui m’a vu grandir. Mais même en essayant d’être le plus fidèle possible à mes souvenirs, j’ai fourni une réécriture du passé, une recomposition, parce que la mémoire est imparfaite et parce qu’écrire, c’est toujours une médiation. J’ai donc tenu à garder la mention « roman » car si tout y est vrai, le filtre qui se pose sur le contenu biographique vient forcément le modifier légèrement.
C’est un livre qui revendique le droit d’être nostalgique … Je parle de la nostalgie heureuse, agissante, pas d’une nostalgie qui accable, une nostalgie de regrets qui fige. Ma nostalgie est liée à notre société, à notre époque, où l’espoir que ça ira mieux demain a disparu. La faute à la crise énergétique, climatique, économique … A travers ce roman, par petites touches, à la manière de polaroids, d’instantanés de vie, j’essaie de montrer comment des petites choses du quotidien, le travail de la terre et les savoirs anciens notamment, pourraient nous aider à nous réapproprier le présent sous une forme plus apaisée. En ce sens, oui, j’aime cette nostalgie agissante.
Vous écrivez : « On vivait la vie que les gens vivaient alors, une vie où s’il y avait bien une chose qui n’existait pas, c’était l’envie de se mettre en avant ». Comment faites-vous, Antoine, pour vivre dans une époque obsédée par les réseaux sociaux ? Quand j’ai écrit « Nos mères », publié en 2014, je n’étais pas sur les réseaux et je n’avais pas d’attente. Je vivais chaque jour de promotion avec ce qu’il comportait de bonnes nouvelles ou de rien, juste le silence. Pas de retour, pas d’article. Ce silence, c’était charmant. J’aime les relations avec les lecteurs mais je n’ai pas besoin de les voir sur Facebook avec la couverture de mon livre. Dans les années 80, avant la cassure, avant l’accélération des années 90, les réseaux sociaux n’existaient pas. Ne pas être obligé de se mettre en avant est une vertu qu’il faudrait peut-être se réapproprier aujourd’hui.
« Tout vient de là », s’il me fallait résumer votre livre en une phrase, ce serait celle-là. Parfois pourtant, il faut savoir partir de là … Evidemment. Le roman est d’ailleurs lié à un départ. J’ai étudié à Bruxelles, enseigné à Bruxelles, j’y ai vécu, j’ai voyagé grâce à mes livres. Ce n’est qu’aujourd’hui que je suis en mesure de revenir sur les terres qui m’ont vu grandir, et d’y puiser ce qui m’aide à tenir dans le grand chaos dans lequel on se trouve aujourd’hui…
Pourquoi y revenir aujourd’hui ?
Parce que c’est lié à un changement dans ma manière d’envisager la littérature. Pendant longtemps j’ai écrit des fictions, ce qui suppose non pas de se détacher du monde réel, mais de créer un monde qui transforme cette réalité, qui l’amène ailleurs. Ma décision de revenir en Ardenne belge coïncide avec une volonté de retourner au réel, de parler de moi, de ce qui m’entoure, d’histoires locales, de réveiller des mémoires enfouies dans ces lieux-là. « Le plus court chemin » s’apparente à un documentaire à la manière de Raymond Depardon au cinéma.
Enfant, vous étiez un solitaire. Est-ce toujours le cas ? Je le crois, je le crains. Je me suis probablement mis à écrire pour me cacher du bruit. L’écriture me sert de refuge. Et cet enfant qui avait des difficultés à se lier aux autres, oui, il est toujours présent en moi.
MAXIME CROISÉ, l'or pour la Belgique
MAXIME CROISÉ
L’or pour la Belgique
MAXIME CROISÉ
L’or pour la Belgique
MOTS : SERVANE CALMANT
PHOTO : DAVID OLKARNY
Nouveau prodige belge de la magie, le Brabançon Maxime Croisé, 22 ans, vient de remporter une Médaille d’Or au World Championships of Performing Arts (WCOPA) de Los Angeles. Qui est-il ? Comment a-t-il séduit le jury ? Où voir ce jeune magicien-artiste à Bruxelles prochainement ? On vous dit tout.
Comment êtes-vous tombé dans la marmite à magie ? En week-end à Londres, il y a quatre ans, j’ai poussé la porte d’un magasin de magie. J’en suis ressorti avec un jeu de cartes et un livre sur le sujet. Pendant le confinement, j’ai eu beaucoup de temps libre, j’ai appris pas mal de tours, j’en ai créé d’autres, je me suis entraîné chez moi devant ma famille, en zoom devant des amis d’université, j’ai posté des tours sur Instagram… Le matin, je me réveillais, et je pensais magie ; la nuit, je rêvais magie. J’ai assez rapidement développé une véritable passion pour cet art !
Comment se perfectionne-t-on ? Grâce aux livres de magie qui sont de précieu- ses sources théoriques et pratiques et aux rencontres avec d’autres magiciens en ligne ou lors de résidences de magi- ciens, notamment chez Dani DaOrtiz, un cartomane espagnol exceptionnel, que je considère comme mon mentor. La transmission du savoir compte beaucoup dans cet art. On s’améliore, on se perfectionne à l’écoute des autres.
C’est la première année qu’une équipe de Belgique participe au WCOPA et, bingo !, vous ramenez une médaille d’or. Avec quel tour avez-vous séduit le jury du Championnat du Monde des Arts de la Scène ? Le WCOPA est un peu spécifique, il regroupe plusieurs catégories (danse, mannequinat, chant, musique, variété/cirque/magie – nda) et son objectif est de lancer des carrières. Je faisais partie d’une délégation belge de 17 candidats. Je me suis présenté dans la catégorie « Magic Open » où tous les tours sont permis. J’ai eu 1’30 pour capter l’attention du public et montrer le meilleur de moi-même. J’ai donc particulièrement travaillé ma présence scénique, le show. Mon numéro est silencieux et mélange magie et jeu d’acteur.
Sortir un lapin de mon chapeau, ce n’est pas votre style ! Exactement ! Je me définis comme un magicien moderne, qui essaie de déconstruire les clichés autour du magicien et interagit avec le public. J’aime particulièrement raconter des histoires, scénariser mes tours, maîtriser un storytelling pour mettre en récit un tour de magie.
Vous proposez de la magie de close-up, de scène et de la magie promotionnelle. Explication ! Le close-up, c’est de la magie de proximité, qui se déroule dans des cabarets clubs, et qui implique de faire voir à un public restreint, des effets réalisés avec les mains et n’importe quel objet ordinaire, des billets, des cordes, des clés… J’aime beaucoup l’intimité que l’on arrive à créer avec le public, lors de ce genre de soirées. La magie de scène constitue un show, s’adresse à un public plus nombreux, et l’aspect visuel y est forcément très important. Quant à la magie promotionnelle, elle est utilisée pour renforcer l’image d’un produit ou d’un message. Je me sens à l’aise dans les trois catégories, mais pour l’instant, je pratique surtout le close-up.
Vous avez les pieds sur terre pour un magicien ! (Rire). J’essaie de mettre à profit mes études pour continuer à faire de la magie. Je termine un master en entrepreneuriat, et je propose parallèlement de la magie marketing, c’est-à-dire de la magie avec des produits à l’attention des entreprises. J’ai débuté en septembre un stage chez Levita, une agence créative liégeoise créée par deux prestidigitateurs, Philippe Bougard et Clément Kerstenne, qui ont conçu une technologie unique qui permet de mettre en lévitation des produits ou des œuvres d’art. Ils travaillent avec de nombreuses marques de luxe, partout dans le monde.
Quelle fulgurante aventure ! Incroyable en effet. D’un jeu de cartes à 18 ans à de nombreuses opportunités de carrière réjouissantes à 22 ans. Sans taire que la magie m’a aidé à libérer mon potentiel et à gagner confiance en moi. Et, par-dessus tout, il y a le plaisir de la rencontre avec le public et d’autres magiciens.
Quel magicien vous fascine ? David Blaine, ses performances à grand spectacle dans le domaine de l’endurance, sont incroyables. C’est un véritable performer, comme Houdini le fut à son époque.
Où se rendre pour vous voir ? Avec deux amis magiciens, nous allons proposer prochainement des soirées « Mystery Cabaret » qui mêlent magie, mentalisme et étrange, au « Petit Chapeau Rond Rouge », un café-théâtre situé sur le site du Collège Saint-Michel à Etterbeek.
PAUL COLIZE, échos d’histoire
PAUL COLIZE,
échos d’histoire
MOTS : BARBARA WESOLY
PHOTO : IVAN PUT
Le romancier belge maîtrise à merveille l’art d’anéantir les certitudes et de troubler les consciences, au service d’une intrigue brûlante. « Devant Dieu et les hommes », son dix-huitième ouvrage, s’articule en chronique judiciaire d’un meurtre perpétré dans l’enfer souterrain de la catastrophe minière du Bois du Cazier. Et nous laisse à bout de souffle.
Dans “Devant Dieu et les hommes”, vous empruntez les traits d’une jeune journaliste des années 50, évoluant dans un univers presque exclusivement masculin et victime constante de sexisme. Était-il complexe d’en- trer dans sa peau ? Pas vraiment. J’ai grandi les années 60, où des sphères comme celles de la justice et des affaires étaient presque uniquement dévolues aux hommes. Mais, surtout le vécu de Katarzyna, mon héroïne, est fortement inspiré de celui de ma mère. L’invasion de sa Pologne natale par les nazis, la Belgique pour terre d’asile et les traumatismes du déracinement et de la violence de la guerre sont des parts de notre héritage familial que j’avais déjà évoquées dans « Un long moment de silence ». La choisir pour personnage principal offrait l’occasion de faire entrer son passé en résonance avec l’histoire des deux accusés dont nous suivons le procès, inventé de toute pièce, et celle, bien réelle, du Bois du Cazier.
Justement, ressent-on une certaine pression à traiter d’un évènement qui a marqué à vif tout un pays, comme ce fut le cas de la catastrophe minière du Bois du Cazier ? Au contraire, cela m’a boosté. Je désirais évoquer un drame dans un autre, un désastre personnel au sein d’une tragédie bien plus vaste. Étant Belge, les images du Bois du Cazier mais aussi de l’incendie de l’Innovation se sont tout de suite imposées à moi. Mais le premier m’inspirait particulièrement, pour la dimension et le contexte social qui y étaient reliés. Je me suis donc rendu sur place, pour me laisser inspirer par les lieux. Un homme y déambulait également. Je me suis dirigé vers lui, sentant qu’il me fallait lui parler. C’était Urbano Ciacci, l’un des derniers survivants et considéré comme passeur de mémoire. Il était présent le jour de la catastrophe, mais revenant tout juste de son mariage, il n’était pas dans la mine. Suite à sa rencontre, témoigner de cet évènement est devenu une évidence.
D’autant que, 65 ans plus tard, les thématiques du livre demeurent toujours brûlantes d’actualité. L’immigration italienne au sortir d’une guerre, les conditions de vie et de travail des mineurs et le rejet de la population à leur égard, tout cela trouve beaucoup de résonance avec la crise des migrants et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’exploitation au profit de la productivité et l’inhumanité qui en découle aussi. C’était une manière de remettre en lumière tout le fonctionnement d’une époque, finalement pas si éloignée de la nôtre. Avant d’être un roman, « Devant Dieu et les hommes » a d’abord été une pièce de théâtre qui plaçait les spectateurs dans le rôle des jurés. En fin de procès, il leur revenait de voter pour définir la culpabilité des accusés. Le public était électrisé par ces enjeux et les rebondissements comme les injustices abordées par l’histoire. Cela a achevé de me convaincre de la force de ce sujet, encore aujourd’hui.
Ce n’est pas la première fois que vous mettez en scène un journaliste. C’était notamment déjà le cas dans « Zanzara », avec Fred, jeune pigiste web. Ce métier vous inspire ? Je trouve le journalisme d’investigation extraordinaire. C’est palpitant de recouper et disséquer les informations. Et c’est un principe que je développe également dans mes livres, surtout lorsqu’ils comprennent une dimension historique. J’adore plonger sous la surface des évènements pour livrer à mes lecteurs des éléments qu’ils ne trouveront nulle par ailleurs. Mais, plus encore que le métier de journaliste, j’aime mettre en scène des personnages qui tout en étant au cœur de l’action, ne sont pas des policiers et n’ont pas pour vocation de chercher un coupable.
Après « Un monde merveilleux », qui nous conduisait en 1973 à travers l’Europe et l’histoire, et « Devant Dieu et les hommes », qui faisait de nous les témoins d’un crime dans les charbonnages, quel sera le sujet de votre prochain livre ? Il s’agira d’un changement total de style, puisque je suis en train d’achever un roman policier classique. Après plusieurs romans assez sombres, j’avais envie de légèreté et de m’amuser.
“J’aurais pu devenir un Dragon”JÉRÔME COLIN
JÉRÔME COLIN
“J’aurais pu devenir un Dragon”
JÉRÔME COLIN
“J’aurais pu devenir un Dragon”
MOTS : SERVANE CALMANT
PHOTO : GANAELLE GLUME
L’auteur de «Le champ de bataille » livre avec « Les Dragons » un nouveau récit intimiste qui parle d’ados en souffrance. Touchants, bouleversants, les romans de Jérôme Colin ne se contentent pas d’être lus, ils prennent le lecteur à témoin et questionnent un monde de la performance, le nôtre, qui part en sucette…
« Les Dragons », fraichement sorti en librairie et « Le champ de bataille », votre précédent roman, tirent tous les deux la même sonnette d’alarme : nos ados sont en souffrance. Il faut s’en inquiéter. En parler, c’est déjà les aider… Oui, cent fois oui. Il est urgent de mettre le sujet de la santé mentale des jeunes sur la table. Les statistiques en la matière sont effrayantes : depuis la fin de la Covid, 30% des jeunes entre 12 et 24 ans estiment souffrir de troubles anxieux ou de dépression, 1 enfant sur 10 a déjà envisagé le suicide. Les jeunes filles sont particulièrement touchées : on déplore une augmentation de 30% d’hospitalisation pour mutilation auto-infligée et une hausse de 50% des tentatives de suicide.
Comment leur venir concrètement en aide ? D’abord, en les écoutant. Et on se posant les bonnes questions : qu’avons- nous à leur proposer ? Pourquoi vont-ils mal ? L’école remplit-elle sa mission ? Notre société leur convient-elle ? Parlons-en ! Débattons-en.
Jérôme, le narrateur du roman « Les Dragons », est-ce vous ? Non, mais j’aurais pu devenir un Dragon. Je suis allé à la rencontre de ces ados suicidaires, abîmés par l’enfance, anorexiques, qui se mutilent, qui sont en colère. Je devais témoigner de leur souffrance.
Notre société capitaliste responsable du culte de la performance triomphante, vous la condamnez fermement car elle massacre les plus faibles. Quel modèle de société a grâce à vos yeux ? Dans « Dragons », je fais lire à mon narrateur, « Des souris et des hommes », le roman de John Steinbeck d’où ressort cette phrase importante à mes yeux : « la force, c’est d’aimer le faible ». Le modèle de société où j’aimerais vivre ne glorifierait ni les puissants, ni les riches, ni les beaux. Au contraire, on y valoriserait ceux qui arriveraient à aimer les plus faibles qu’eux. Et je ne suis pas catho !
C’est utopique. Oui, ça l’est. Mais ce monde-là, résolument tourné vers ceux qu’on n’entend pas, qu’on ne voit pas, vers les laissés-pour-compte, j’en rêve. C’est la base même d’une société meilleure.
La « normalité » en tant que construction sociale imposée à tous, vous pose problème. C’est même mon principal combat. Je revendique le droit d’être qui on est, tout en évoluant dans la société. C’est notamment pour cette raison, que je suis farouchement contre l’exclusion scolaire. Comment des adultes peuvent-ils s’arroger le droit d’exclure des enfants du seul univers formatif qu’on leur propose ? Le droit à la différence est primordial.
« Penche-toi sur ton passé. Répare ce que tu peux réparer. Et tâche de profiter de ce qui te reste », cette phrase de Philip Roth, vous la citez plus d’une fois. Mais si, Jérôme, rien ne devait se réparer vraiment ? Alors, débrouille-toi avec qu’il te reste. Evidemment que tout ne se répare pas, alors il faut trimballer son sac ! Il ne faut pas se faire d’illusion : on reste toujours l’enfant qu’on a été. Mais il faut vivre. Et vivre, ce n’est pas obéir, se ranger, non, vivre, c’est aller à la rencontre des autres.
Aujourd’hui, Jérôme Colin, journaliste de«HepTaxi!»et de«Entrez sans frapper » (RTBF), se sent-il normal ? Rire. Non, je suis un Dragon pour toujours. Je déteste toujours la notion de hiérarchie, les concepts d’ordre, d’obéissance.
Vos romans prennent le lecteur à témoin, et l’obligent en quelque sorte à questionner le monde. Jérôme Colin, journaliste avant tout ? J’aime raconter des histoires, fortes, pour peu en effet qu’elles me permettent d’ouvrir le débat sur des sujets de société. Mon travail de journaliste nourrit de fait mes récits. Je ne me définis d’ailleurs pas comme un auteur, ni comme un écrivain, mais comme un journaliste qui rédige des histoires…
Expliquez-nous ce titre, « Les Dragons ». Il fait référence aux cicatrices laissées par une scarification massive, qui m’ont fait penser à des écailles de dragon. Il m’a également été inspiré par un globe terrestre, dit globe de Lenox, qui date de 1504, où figure l’indication « Hic sunt dracones » (ici, sont les dragons) qui marque la limite du monde connu. Au-delà, il y a cet inconnu qui nous fait peur. Y vivent ceux qu’on ne connaît pas : les Dragons. J’avais trouvé mon titre.
« Le champ de bataille », franc succès littéraire, adapté au théâtre avec succès, va être prochainement adapté au cinéma. Qui sera derrière la caméra ? « Les Dragons » connaîtront le même destin ? Le scénario de « Le champ de bataille » est terminé, il aura nécessité un an de travail. Je l’ai co-écrit avec Olivier Masset-Depasse (« Cages », « Duelles ») qui en sera le réalisateur. Nous entrons dans la phase de production. « Les Dragons » sera également adapté au théâtre au mois de mai, et devrait connaître une adaptation cinématographique…
ALBERT BARONIAN 50 ans d’art
ALBERT BARONIAN
50 ans d’art
Mots : Olivia Roks
Photos : Fabrice Schneider, Leila Johnson
Figure majeure de l’histoire des arts visuels en Belgique, Albert Baronian est aussi à l’origine d’une des plus anciennes galeries belges en activité. Cette année, elle fête ses 50 ans avec une exposition anniversaire à la fondation CAB. Échange avec ce galeriste atypique.
Comment vous êtes-vous épris d’amour pour l’art et plus particulièrement l’art contemporain ? Après mes études, pour apprendre l’an- glais, mes parents m’avaient envoyé à Londres où j’étais garçon au père. Pendant mon temps libre, comme tout touriste, je visitais la ville. Je me suis rendu à la Tate Gallery et je suis tombé sur des tableaux de Rothko. J’étais étonné car le musée était plutôt sérieux, tout comme les Anglais. En quittant le musée, je suis passé à la boutique et je suis reparti avec des livres sur l’art abstrait. De retour en Belgique, je cherchais à croiser la route de l’art contemporain… C’est devenu un virus. Je n’ai pas fait histoire de l’art mais des études en sciences politiques et sociales. Mais parallèlement, j’étais obsédé par l’art contemporain. J’ai appris seul, sur le tas, par passion, par amour.
Et vous voilà cette année à fêter vos cinquante ans de galerie, un chiffre incroyable, rappelez-nous vos débuts, la naissance de la galerie… J’ai fait la rencontre de Jo Delahaut, peintre abstrait, décédé aujourd’hui. Il m’a permis de rencontrer d’autres artistes. En septembre 1973, j’ai proposé à Antonio Odias de faire une petite exposition d’éditions dans mon appartement bruxellois boulevard Saint-Michel mais il est arrivé avec des œuvres uniques. De fil en aiguille, tout s’est enchaîné : plusieurs expositions à l’appartement, des œuvres qui s’accumulent jusqu’à la cuisine et enfin le besoin de chercher un autre espace pour exposer. Je me suis retrouvé dans un magnifique espace rue des Francs et ensuite les lieux se sont succédé jusqu’à celui-ci, rue Isidore Verheyden, dans le quartier Louise.
Au fil de ces années, quelle a été l’évolution de vos choix artistiques ? Au début je m’intéressais beaucoup à la peinture analytique, ensuite est venu l’arte povera, un mouvement fort et très politisé à l’époque. Mais dès le départ je n’avais pas de ligne conductrice stricte, j’étais plutôt dans l’éclectisme, avec une certaine rigueur et un choix très personnel. A l’époque, avec moins de collectionneurs, moins de galeries, moins d’artistes, le choix était, il me semble, plus facile, il y avait des évidences. Aujourd’hui, l’art contemporain (avant appelé art d’avant-garde) est devenu très à la mode, il y a une pléthore d’artistes, de galeries… L’art est aussi un bien économique. L’émergence de pays comme le Brésil, la Chine, le Japon a amené la spéculation des artistes et cette spéculation est aussi amplifiée par les salles de ventes. De jeunes artistes peuvent avoir des cotes folles en quelques années. Je le dis souvent, ces dernières années, le marché de l’art a pris le pas sur l’histoire de l’art…
Autodidacte, éclectique, vous avez un profil de galeriste atypique… Dans le paysage bruxellois belge, c’est vrai, on me l’a déjà dit, je revendique en quelque sorte cet atypisme. Je viens d’une famille d’immigrés arrivés en Belgique en 1930, mes parents ont travaillé pour que leurs cinq enfants fassent des études. Ils ne viennent pas du milieu de l’art mais ma mère nous a inculqué le goût des belles choses. Je suis devenu galeriste sans savoir ce qu’était être le métier de galeriste en amont, j’ai commencé avec rien. Aujourd’hui devenir galeriste, c’est bien différent…
A travers ces années, quelle est votre plus grande fierté ? La fierté d’être toujours là cinquante ans plus tard. La fierté aussi d’avoir fait connaître certains mouvements importants, d’avoir eu l’amitié de Jan Hoet…
Depuis début septembre, une expo- sition à la Fondation CAB retrace vos cinquante années de galerie, qu’allons-nous y découvrir ? J’ai voulu montrer une trentaine d’artistes qui ont été importants pour moi à un moment dans mon histoire, des artistes qui prouvent aussi que j’ai aussi été précurseur en les choisissant comme Lynda Benglis, Lionel Estève, Gilbert & George, Matt Mullican, Alain Séchas, Philippe Van Snick, Stanley Withney entre autres. Une condition du directeur, Hubert Bonnet : pas d’artistes figuratifs. Le CAB est très minimal, conceptuel. Donc ce n’est pas une rétrospective, il manque nombreux artistes pour retracer idéalement mon parcours. Une exception tout de même pour Gilbert & George qui ont répondu présent à mon invitation à l’inauguration de l’exposition. Je me suis dit « mon Dieu, ils ne peuvent pas être là sans la présence d’une de leurs œuvres », surtout après quatre ou même cinq expositions sur leur travail ! Quand Gilbert & George vous offrent une exposition, c’est un cadeau, il ne faut jamais oublier cela !
En parallèle, qui peut-on venir découvrir à la galerie actuellement ? De septembre à novembre, on retrouve Gilberto Zorio, sculpteur, Giulio Paolini, vraie star à l’époque et Giorgio Griffa, peintre, trois artistes de la même génération.
La fin du monde de THOMAS GUNZIG
La fin du monde de
THOMAS GUNZIG
Mots : Barbara Wesoly
PHOTOS : Anthony Dehez
C’est dans un univers au seuil de son anéantissement, où ne demeure de l’humanité qu’une famille retirée sur une île à distance du chaos, que nous emporte Thomas Gunzig, dans son nouveau roman « Rocky, dernier rivage ». Un fascinant huis clos à ciel ouvert, prétexte à évoquer avec le romancier belge son rapport au monde et à l’écriture.
« Rocky, dernier rivage » raconte l’effondrement de notre civilisation. Si le survivalisme est largement abordé dans la littérature, la vision d’une famille millionnaire, préservée par son argent est bien plus rare. Pourquoi ce choix ? Les récits de fin du monde sont souvent très âpres. Les gens y sont généralement affamés et en proie à la brutalité. J’avais envie de raconter une histoire où la survie est assurée, avec assez de nourriture et de confort, mais où les conditions sociales sont compliquées. De me demander ce qu’il advient de l’identité humaine, une fois devenus les derniers sur terre et alors que toute forme de culture s’est éteinte. Qui sommes-nous fondamentalement lorsqu’on retire le vernis de civilisation ? Que sont nos souvenirs, qu’est-ce qu’un lien familial ? Et qu’est- ce qui relie encore les humains quand toute société a disparu ?
Vos quatre personnages principaux, le père, la mère et les deux enfants adolescents évoluent sur cette île, dans l’enfermement profond de leurs senti- ments et du deuil de cet avenir qu’ils ne connaîtront pas. A qui vous êtes-vous identifié parmi ces survivants ? A chacun d’entre eux. Un roman se construit toujours avec des morceaux de son être, même si l’exercice qui m’intéresse le plus est d’arriver à les métaboliser pour en faire des récits qui ne sont pas les miens. J’aime ce geste qui consiste à ne pas croire que sa propre histoire soit forcément digne d’intérêt. Inventer est une des choses les plus étonnantes et extraordinaires qui soit.
La solitude y est aussi un personnage à part entière. Apportée par le silence le plus absolu, lorsque toute musique, littérature ou cinéma s’est tu. Supporteriez-vous de vivre à distance du monde ? C’était en effet l’occasion de me poser la question du rôle de la fiction et de l’art. L’imaginaire est selon moi le bien le plus précieux du survivaliste, dans son adaptation face à l’impensable. J’ai par ailleurs toujours eu un désir de solitude très fort. J’enviais presque mes personnages pour leur vie en autarcie. C’est un vieux fantasme, mais j’ai des enfants que j’aime et qui me maintiennent bien ancré ici.
Votre livre évoque les enjeux environnementaux et l’obsession du profit, de la réussite. Et rappelle ainsi votre roman « La vie sauvage ». L’histoire de cet adolescent, qui après avoir grandi dans la jungle, suite à un accident d’avion, retrouve à seize ans sa famille en Belgique et doit faire face au choc d’un univers aseptisé, pollué et nourrit à la surconsommation. Souhaitiez-vous questionner une nouvelle fois notre oubli de l’essentiel ? Oui. J’ai cette conviction que les humains ne se considèrent pas comme faisant partie du champ du vivant, mais en propriétaires de notre planète. Qu’on en dispose et qu’on l’enlaidit. D’un côté il y a ce regard d’un adolescent sur un univers dominé par l’homme et de l’autre, d’individus ultras civilisés aux prises avec un monde qui redevient dominant et qu’ils tentent encore de dompter.
L’un des héros de « Rocky, dernier rivage », y rédige un livre dont il ne sait s’il sera un jour parcouru par quelqu’un. De votre côté, écrivez-vous pour ces lecteurs qui seront au rendez-vous au-devant de ces pages, ou avant tout par plaisir personnel ? Je n’ai pas du tout sa pureté. Je pense que chez tout auteur, se mêlent deux parts. Celle qui cherche à créer le meilleur et celle qui espère être lue et appréciée par le plus grand nombre. Si l’on me disait demain que mes livres ne seraient plus lus que par ma maman et mon chat, c’est sûr, j’arrêterais. Le désir de reconnaissance, d’amour et de partage est bien trop profond.
Justement, si vous aviez un fantasme en matière d’écriture ?
J’aimerais me plonger dans un fait historique complexe ou aller à la découverte d’une profession méconnue. Mais surtout je souhaite désormais écrire sans craindre la manière dont cela sera accueil- li et seulement en fonction de mes désirs profonds. Mais d’abord, accueillir la sortie de « Rocky, dernier rivage ». Et surtout le voir adapté pour le cinéma. Les droits sont vendus à la société de production de Jaco Van Dormael. Nous travaillons à quatre mains au scénario, avant qu’il ne réalise le film. J’en suis particulièrement heureux. Nous déjà partagé de multiples projets et Jaco a cette qualité très rare d’élever les talents de ceux avec qu’il collabore et la beauté des œuvres qu’il transpose. »
TOM D. JONES, narrateur du vivant
TOM D. JONES
Narrateur du vivant
Mots : Barbara Wesoly
Photos : Tom D. Jones
Photo portrait : Sylvia Jones
Une part de ses clichés capture la beauté des paysages solitaires et des contrées inhabitées. L’autre apprivoise au plus près le regard indompté des animaux sauvages. Mais toutes les œuvres du photographe d’art Tom D. Jones ont pour essence une envoûtante sérénité.
De la photographie ou de la nature, quel était votre premier amour ? Ma femme et moi sommes tous deux photographes et en 1999, nous avons lancé notre studio à Knokke. Celui-ci a rapidement rencontré le succès mais avec lui, le stress et les délais serrés. Je me suis retrouvé à passer la majorité de mon temps derrière un ordinateur plutôt qu’un appareil, trop occupé par la pré et postproduction. Mon échappatoire consistait alors à aller marcher sur la plage. Durant ces balades, j’ai commencé à capturer des images du littoral et de la mer. C’est comme cela que mon intérêt a évolué vers la photographie artistique. Ma fascination pour les animaux a, elle, débuté lors d’un voyage en Tanzanie en 2012. Je m’y suis découvert une véritablement connexion avec la savane et la quiétude incomparable des contrées reculées d’Afrique de l’Est.
Vos clichés de panoramas déserts côtoient ceux d’une vie sauvage bouillonnante. Demandent-ils une pratique différente de votre métier ? L’un comme l’autre sont de véritables challenges. Les paysages impliquent de choisir un cadre et d’y attendre que la lumière et l’horizon se modifient doucement. Immortaliser la faune nécessite une tout autre maîtrise, plus proche de la photographie de portraits. Quand on travaille sur du vivant, on ne peut rien contrôler et les animaux ne sont absolument pas coopératifs. Il s’agit de capturer l’instant parfait. Et c’était d’autant plus complexe, sachant que je me suis toujours refusé à photographier des animaux qui n’évolueraient pas en totale liberté. Malheureusement derrière de trop nombreuses photographies animalières se cachent des conditions de captivité horribles.
Vous ressentiez le besoin de révéler leur vérité plutôt que celle dictée par l’homme ? L’humain ne laisse pas de place aux autres espèces et à leur épanouissement. Si nous continuons, cette voie causera notre perte. Ce projet m’a amené à voyager dans de multiples pays, mais les seuls endroits où j’ai pu observer des animaux véritablement libres étaient au Kenya et en Tanzanie. Il existe en revanche tellement de réserves privées où les animaux sont traités comme des objets touristiques.
Lions, rhinocéros, ou encore éléphants. Comment parvient-on à des photographies d’une telle proximité et des échanges de regards d’une telle profondeur ? Par l’apprivoisement et la patience ? En commençant ce projet, je n’avais aucune connaissance de la faune et de ses habitudes, mais au fil des ans j’ai appris énormément au contact des animaux mais aussi des rangers et guides qui m’accompagnaient, c’est pourquoi je retournais continuellement dans les mêmes parcs nationaux du Kenya. Prendre de tels clichés nécessite d’abord de découvrir l’environnement idéal. C’est pour moi l’élément déterminant. Et, lorsqu’on arrive sur le territoire d’un animal, il y a toujours au départ une forme de tension, une extrême conscience de notre présence en tant qu’intrus. Il faut rester calme, silencieux jusqu’à ce que soudain, il recommence à agir normalement. Un rapprochement devient alors possible. Certaines espèces sont également curieuses, comme les éléphants ou les gorilles des montagnes, qui soudain étaient à côté de moi. C’était inouï. Tout cela demande une immense patience et de nombreux jours sans être productif, sans même prendre la moindre photo.
Après la publication en août du livre True Wildlife, dédiée à vos portraits animaliers, vous inaugurerez en septembre une exposition éponyme, à Knokke. Celle-ci comprendra plus de 50 clichés, saisit durant sept ans. Aviez-vous prévu de la documenter si longtemps ? Pas vraiment, mais c’était sans doute inévitable vu ma façon de travailler. Être photographe artistique implique de réaliser des images destinées à l’impression en grande taille. Le résultat ne laisse aucune place à l’erreur. Et surtout, il n’était pas question pour moi d’utiliser un téléobjectif, comme le fond beaucoup de photographes animaliers. Leurs clichés longue distance sont souvent incroyables, mais volent ces instants aux animaux. Je tenais privilégier l’intimité avec eux.
Retournez-vous prochainement au Kenya, pour débuter une nouvelle série ? Pour l’instant, je m’occupe des derniers détails de l’exposition et de la promotion du livre. Une fois achevé, je pense prendre le temps de voyager pour me reposer. Je prépare des projets au Groenland et je demeure toujours à la recherche de nouveaux challenges, mais j’ai besoin de respirer et de me laisser inspirer. C’est ainsi que ma créativité pourra à nouveau pleinement émerger.
TRUE WILDLIFE
Centre culturel Scharpoord de Knokke-Heist, du samedi 23 septembre au dimanche 12 novembre.
L’envol d’ AMÉLIE NOTHOMB
L’envol d’ AMÉLIE NOTHOMB
Mots : Barbara Wesoly
PHOTOS : JEAN-BAPTISTE MONDINO
Ses mots résonnent comme une libération. Et nous entrainent dans l’abîme de sa souffrance puis à la genèse de sa renaissance portée par l’écriture. Avec « Psychopompe » son 32e ouvrage, Amélie Nothomb se livre avec profondeur et guide sa plume au zénith.
« Psychopompe » s’inscrit comme le troisième volet d’un triptyque, commencé avec « Premier Sang » et « Soif ». C’est aussi l’un de vos livres les plus personnels, racontant des évènements très traumatiques de votre enfance et adolescence. L’écrire s’est-il révélé une forme de catharsis ? Certainement mais plus encore, il m’a permis de comprendre énormément sur moi-même, dont cette obsession de l’oiseau, devenue consciente à l’âge de onze ans. Ce livre m’a amené à enfin percevoir le rôle qu’elle avait joué dans mon existence, notamment dans sa relation intrinsèque à la mort, elle qui m’a toujours obsédé également. Or l’oiseau est un très puissant vecteur de vie. Et avoir hautement conscience de sa mortalité ne rend pas morbide, au contraire, cela donne envie de vivre encore plus fort.
Le « Psychopompe » se définit dans la mythologie comme celui qui guide l’âme des défunts. Dans cet ouvrage vous questionnez ainsi le sens de l’existence tout autant que celui de l’après. A-t-il fait progresser vos réflexions ? Ma propre mort n’est pas du tout un problème pour moi, au contraire, c’est presque un motif de réjouissance. Je suis sure que mourir doit être une expérience très intéressante et je l’attends de pied ferme. Le départ des êtres chers c’est par contre terriblement grave. En expliquant être moi-même psychopompe, je raconte comment finalement contre toute attente, le décès de mon père s’est très bien passé. Cela a d’abord été une tragédie, dont j’ai beaucoup souffert, mais finalement, je me suis rendu compte que mon père avait parfaitement réussi sa mort. Et j’y vois un message d’espoir. J’avais de très bonnes relations avec lui de son vivant mais elles sont encore meilleures depuis qu’il n’est plus vivant. C’est prodigieux et cela prouve qu’il n’est jamais trop tard.
Votre rapport à la mort est aujourd’hui apaisé ? Je suis convaincue que la mort n’est pas une terre étrangère et c’est terriblement salvateur. J’ai perdu deux êtres que j’aimais d’un très grand amour, dont mon père, et j’ai longtemps cru que je ne m’en remettrais jamais. Or, finalement il y a un extraordinaire soulagement à s’apercevoir qu’il reste un lien dans l’après et que l’évolution de la relation ne s’arrête pas à ce départ. La mort n’est pas la cessation de l’amour, en aucune manière.
La quatrième de couverture de « Psychopompe » pose comme derni- ers mots : « Écrire c’est voler ». Au-delà de ce besoin que vous décriv- ez comme vital, on en ressent une part spirituelle. Oui, je suis définitivement une mystique. J’appartiens à une famille très catholique mais cela ne me suffit pas. J’ai besoin, non seulement de m’abreuver de toutes les croyances mais surtout de nourrir mon propre rapport à la transcendance. Je me considère comme une bricoleuse métaphysique.
Convoquer ces blessures vous amène- t-il à cultiver de la bienveillance envers vous-même ? L’écriture m’a sauvé la vie, très concrètement. Ce n’est pas une métaphore. Mais pour en atteindre un tel degré, il faut convoquer sa sensibilité et l’on en ressort forcément fragilisé. La bienveillance envers moi-même, c’est vraiment mon talent d’Achille. Mais je sais que je dois y aspirer donc je m’y contrains. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, raconter mon propre viol à l’âge de douze ans et demi est un mouvement en ce sens. Le plus grand danger était que cette épreuve soit frappée d’irréalité, ce qui correspondrait à une double peine. Ce qui m’est arrivé n’a pas été constaté. Pour moi l’écrire c’est dire « je n’ai que mon témoignage à vous apporter, mais il suffit ».
Est-il complexe d’écrire à nouveau après être allé aussi loin dans l’intime ? C’est à la fois monstrueusement difficile et totalement salvateur. On ne peut pas rester sur quelque chose d’aussi grave que « Psychopompe », il faut changer de registre, continuer à vivre. C’est indispensable. Je ne dirai par contre rien sur le livre que je suis en train d’achever. J’ai toujours affirmé ne pas pratiquer l’échographie parce qu’en l’occurrence, elle serait très dangereuse. Ce ne serait pas sans influence sur le bébé et là j’en suis au stade où je protège mon ventre de tous mes bras.
JACQUES-HENRI BRONCKART : « Les rencontres avec les cinéastes guident mes choix de producteur »
JACQUES-HENRI BRONCKART
« Les rencontres avec les cinéastes guident mes choix de producteur »
MOTS : SERVANE CALMANT
PHOTOs : ANTHONY DEHEZ
Depuis 20 ans, Jacques-Henri Bronckart permet au cinéma belge et étranger d’éclore sur grand écran. Le Liégeois a le nez fin ! Assez pour produire coup sur coup « Nobody has to know » de Bouli Lanners, « Close » de Lukas Dhont et « La nuit du 12 » de Dominik Moll. Des films incontournables, multiprimés chez nous et à l’international.
Vous avez fondé Versus Production en 1999 pour produire, dans un premier temps, des courts-métrages belges, notamment ceux de Bouli Lanners et d’Olivier Masset-Depasse. A l’époque, c’est l’amitié qui guidait vos choix. En 2023, est-ce toujours le cas ? Plus de 20 ans dans la production. Quand je regarde dans le rétroviseur, j’en ai le vertige, ça passe tellement vite. La motivation est cependant restée la même, je fais toujours ce métier par amour du cinéma et des auteurs. Mais la profession a évolué : au début, nous produisions de manière plus artisanale, nous montions des projets un peu fous que nous portions sur nos épaules en rêvant de les voir se concrétiser avec une certaine naïveté. C’est toujours le cas, sauf qu’aujourd’hui, la production s’est complexifiée et les projets que nous portons ont une autre envergure. Notre back-office s’est sensiblement renforcé : pour gérer nos productions, on a besoin de nombreuses compétences qui vont de la fiscalité au juridique. Et la spécificité de la Belgique n’arrange rien ! Il faut solliciter trois niveaux de pouvoir, le Fédéral pour l’aspect fiscal (le Tax-Shelter), les Régions pour le côté économique, la Fédération Wallonie- Bruxelles pour le culturel. Bref, produire en Belgique, c’est beaucoup de paperasserie mais c’est aussi une place stimulante qui nous pousse, pour atteindre l’ambition de nos films, à coproduire avec d’autres pays.
Qu’est-ce qui guide vos choix ? Pas la paperasserie en tout cas ! (Rire) Ce sont les rencontres avec les cinéastes qui guident clairement mes choix.
Vous avez produit tous les films de Bouli Lanners, d’Olivier Masset- Depasse. Versus Production est fidèle ! Oui, la collaboration sur le long terme permet d’apprendre à connaître les auteurs et d’aller plus loin.
Et quand l’envie disparaît ? Il faut décider d’arrêter l’aventure. Ne jamais se forcer, écouter son instinct.
Versus Production montre égale- ment un goût prononcé pour les auteurs flamands à l’univers singu- lier… Nous avons en effet accompagné Tim Mielants, Fien Troch, Patrice Toye, Lukas Dhont. Et sortira bientôt le premier long-métrage de Veerle Baetens, « Débâcle », adapté du roman de Lise Spitz.
Vous êtes également gérant d’une struc- ture de distribution de films, O’Brother. Etait-ce une nécessité ? Plutôt une volonté de maîtriser également le circuit de la distribution. Cela nous permet de soigner la sortie de nos films.
Quand vous produisez un premier film, vous prenez beaucoup de risques ? Pas plus que sur un 2e ou 3e film. C’est très excitant de mettre son expérience et son regard au service d’un premier film. Le travail que j’ai initié depuis plusieurs années avec Delphine Girard est passionnant. Son court-métrage, « Une sœur », nous a amenés aux Oscars et nous venons d’achever la postpro- duction de son premier long qui est très réussi et que je me réjouis de sortir.
L’accompagnement, c’est le cœur de métier de votre travail ? Produire consiste en effet à offrir aux réalisateurs l’espace nécessaire et sécurisé pour leur permettre d’aller au bout de leur ambition. Ce qui ne signifie nullement leur donner carte blanche. Car il faut tenir compte des nombreux obstacles qui jalonnent la fabrication d’un film. Confronté aux objectifs artistiques et financiers, le producteur joue le plus souvent les équilibristes.
2022, quelle année pour Versus Production ! « Nobody has to know »,de Bouli Lanners, « Close » de Lukas Dhont, « La nuit du 12 » de Dominik Moll, tous ces films que vous avez produits ou coproduits ont été primés en Belgique et à l’étranger. Que nous réservez-vous pour 2024 ? On vient de terminer la postproduction de deux films qui devraient sortir en 2024 : « Quitter la nuit » de Delphine Girard que j’ai déjà évoqué et « Sous le vent des Marquises » de Pierre Godeau, avec François Damiens et la jeune Bruxelloise Salomé Dewaels. Une très belle histoire de réconciliation père-fille. Mais ce qui nous occupe particulièrement pour le moment, c’est le tournage de « Le prix de l’argent » d’Olivier Masset-Depasse, adapté de la BD éponyme (avec Tomer Sisley et James Franco dans les rôles principaux). C’est un film d’aventure ambitieux, avec un budget important, que nous avons financé en plein Covid, en nous heurtant de front à la frilosité d’un marché complètement déboussolé. Avec Olivier, on sort de notre zone de confort et on relève un challenge extrêmement excitant : faire un film d’aventure qui remplit le cahier des charges de la franchise « Largo Winch », tout en lui apportant une dimension actuelle et une touche assez émotionnelle. Le film sortira sur nos écrans au deuxième semestre 2024. Depuis trois ans, nous avons également collaboré avec Netflix qui a considérablement bousculé le circuit de distribution des films. Nous avons produit « Balle Perdue » et sa suite, « Balle Perdue 2 », le troisième opus est en préparation. Nous avons également produit des séries TV, notamment « La Corde » ou « No man’s land » diffusée en 2021 et 2022 sur Arte et d’autres séries sont actuellement en développement avec des auteurs maisons.
L’atelier sedanais de Serge Anton
L’atelier sedanais de Serge Anton
Mots : Olivia Roks
Le photographe franco-belge qui manie à la perfection l’art du portrait revient sur le devant de la scène avec un bel atelier à son image, une exposition où ses photographies mettent en lumière ses voyages et ses rencontres mais aussi une collaboration avec l’innovant support digital belge Ionnyk.
Votre atelier à Sedan est fin prêt. Un projet qui vous tient très à cœur... Mon père est né dans cette ville et j’y suis revenu car j’ai récupéré une maison. Ensuite, j’y ai acheté une presqu’île. C’est un ancien hangar à bateaux, au départ il n’y avait que quatre murs. Après trois années de travaux, je m’y suis fait un super atelier. J’avais envie d’être dans la nature, au bord de l’eau. Le plus important pour un photographe c’est la lumière. Et dans ce bâtiment, j’ai douze fenêtres au-dessus et l’eau tout autour, j’ai donc une lumière extraordinaire. à l’intérieur, j’ai un studio photo fermé, et à l’extérieur, un studio à la lumière du jour. On a l’impression d’être au milieu de nulle part mais je suis à cinq minutes du centre-ville. Pour travailler c’est parfait, j’ai de plus en plus de mal avec la ville. Ici, je trouve une énergie particulière.
Dans cet atelier qui est également votre studio, vous allez proposer des expositions. Qu’avez-vous à l’agenda ? Actuellement et jusque fin août, il y a une exposition mettant mes kasbahs du Maroc à l’honneur. Les clichés se déclinent via trois supports : les cadres digitaux Ionnyk, des tirages chromalux et du papier recyclé. J’ai photographié des kasbahs, ces lieux historiques et spirituels, vus du ciel depuis un hélicoptère il y a une dizaine d’années. Cette exposition s’inscrit principalement dans le cadre d’un gros festival photo : Urbi & Orbi, la biennale de la photographie et de la ville à Sedan. Un parcours artistique à travers différents points d’exposition. L’exposition présentera aussi des portraits de gens vivant dans des kasbahs et des photos de vues aériennes. Mais par la suite, d’autres expositions seront aussi à l’honneur, et pas spécialement sur la photo. Par exemple, j’aime beaucoup la céramique.
On retrouve vos mythiques clichés issus de la collection Faces sur des cadres digitaux Ionnyk. Rappelez-nous l’origine de ces incroyables photos ? Faces est en fait le nom de mon livre qui est malheureusement épuisé. Il reprend trente ans de travail mais surtout beaucoup de portraits du monde, principalement d’Asie et d’Afrique. Depuis mes seize ans, je photographie des visages, tous racontent une histoire. Je travaille au feeling, à l’instinct, à la beauté qui me touche.
Pourquoi l’envie de collaborer avec une start-up belge proposant des cadres digitaux sans câble ? Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être passé au digital ? La femme du propriétaire adorait mes photos et de fil en aiguille ce partenariat très respectueux s’est mis en place. Je ne suis pas sectaire et je suis ouvert à tout. Je sais que certaines personnes vont dire « ce n’est pas du tirage photo ». Mais moi je suis bluffé, ça a la qualité d’un tirage photo, avec une netteté, une matière incroyable et même un passe-partout comme un tirage photo. Les gens sont souvent trompés par le résultat. La technologie est incroyable.
Qu’est-ce que ce type de cadre apporte en plus à vos photographies ? Le plus grand avantage est l’étendue du catalogue Ionnyk. Sur abonnement, Ionnyk donne accès à une application qui offre un catalogue avec une série de clichés issus de Faces. Mes visa-ges sont très puissants, il faut pouvoir les assumer, et ici, impossible de s’en lasser. On peut changer la photo selon ses envies, ses humeurs ou les gens que l’on reçoit chez soi.
Avant de se quitter, des projets à dévoiler ? Je reviens d’un voyage humanitaire, c’était incroyable, je n’avais plus fait cela depuis longtemps. Pourquoi pas réitérer ! J’ai aussi terminé le shooting pour la campagne Baobab Collection de la saison prochaine. Un client pour lequel j’ai toujours énormément travaillé. Enfin, mon éditeur souhaiterait que je fasse un nouvel ouvrage, je dois donc repartir en voyage faire des photos. à suivre donc !