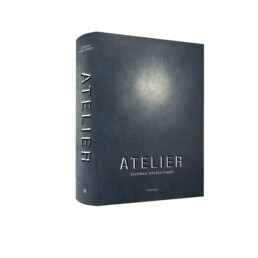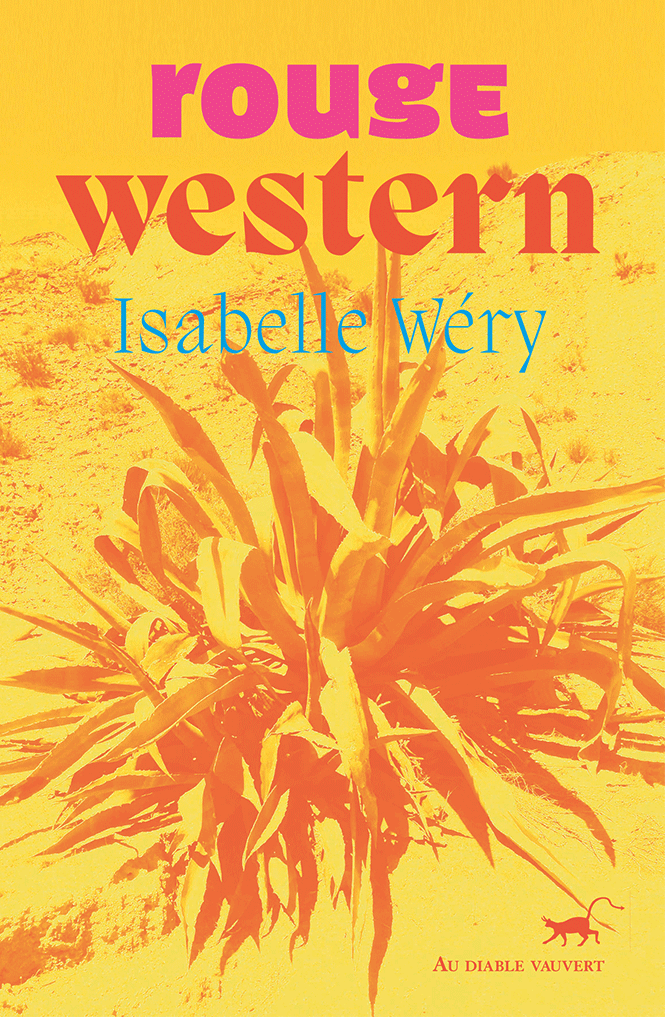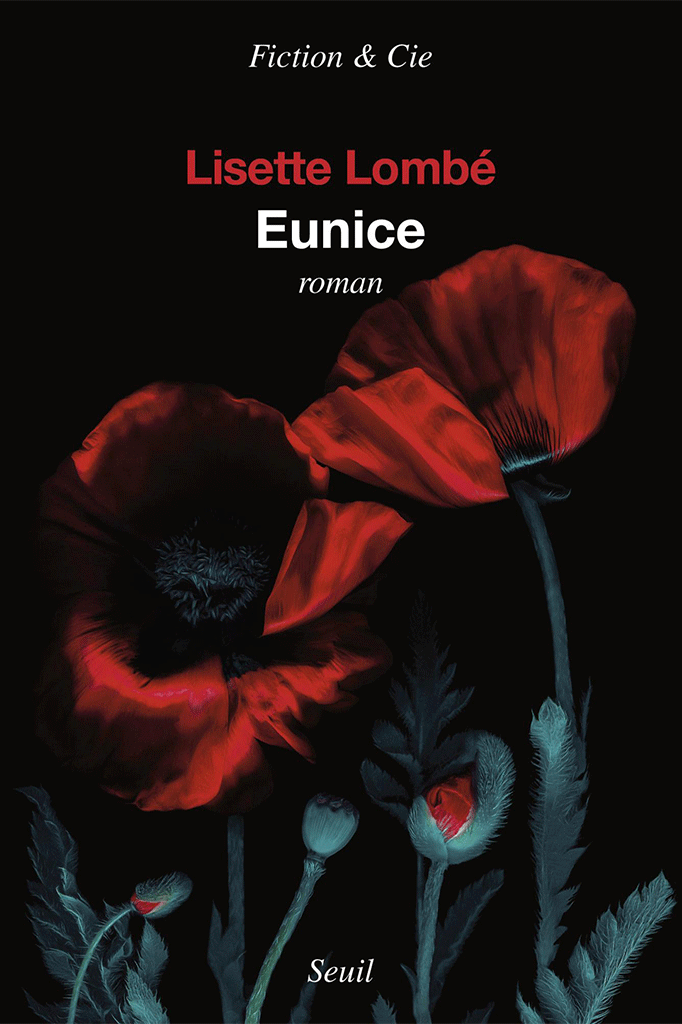Laura Sepul - « J’ajoute un grain de beauté aux visages de mes personnages pour maintenir une relation à distance »
Laura Sepul
« J’ajoute un grain de beauté aux visages de mes personnages pour maintenir une relation à distance »
Mots : Servane Calmant
Photos : Jon Verhoeft
Les fans d’excellentes séries TV belges ont fait connaissance avec Judith (dans Ennemi public), Cynthia (Baraki), Agathe (Attraction), Elisabeth (Quartier des banques). Mais qui est Laura ? La Liégeoise d’origine à la blondeur hitchcockienne avoue adorer les séries – qui le lui rendent bien ! – et s’impose également dans le téléfilm El Correo, à voir sur Netflix en avril.
On sait peu de choses de vous … Je suis née à Liège. A 3 ans, mes parents se sont séparés. C’est ma mère qui m’a élevée. à 9 ans, je suis partie vivre à Ciney avec elle et mon beau-père. A 18 ans, je me suis inscrite au Conservatoire royal de Liège. Je vis depuis 15 ans entre Bruxelles (avec mes deux enfants) et Anvers où réside mon amoureux, Geert Van Rampelberg (acteur, vu notamment dans Knokke Off dans le rôle du père d’Alex – nda). Nous nous sommes rencontrés en 2017 sur le tournage d’un court-métrage belge. Ce fut un véritable coup de foudre. Depuis, nous nous soutenons énormément au quotidien et professionnellement.
De 2005 à 2015, on vous voit beaucoup sur les planches du Théâtre National, notamment. Puis, en 2016, Ennemi Public, série belge, triomphe sur La Une. La création du fonds Fédération Wallonie Bruxelles-RTBF qui impose à la chaîne de « participer à l’objectif d’accroître la production de séries télévisuelles belges francophones » a-t-elle changé votre vie professionnelle ? Oh oui, complètement. J’ai joué dans le premier court-métrage de Matthieu Frances, réalisateur de la série Ennemi Public. Il m’a téléphoné pour m’annoncer que la RTBF lançait un fonds séries… C’était parti ! J’ai enchaîné deux saisons d’Ennemi public, deux saisons de Quartier des banques qui est une série belgo-suisse – je rempile pour la 3e saison dont le tournage est prévu fin de cette année – , deux saisons de Baraki également, et Attraction, mini-série scénarisée par Barbara Abel et Sophia Perié.
Vous reconnaît-on dans la rue ? Oui, parfois. Les séries belges connaissent un véritable succès, elles marquent les esprits et dépassent les frontières grâce aux festivals et aux plateformes de streaming.
Quel personnage a le plus marqué les téléspectateurs ? Je pencherais pour Cynthia dans Baraki, qui est bien plus qu’une comédie déjantée. Il y a une dimension sociale dans cette “dramédie” qui est très intéressante. Sur papier, le personnage était d’ailleurs différent. Pour ce rôle, j’ai profité d’un espace de liberté immense et proposé une Cynthia à mille lieues de la potiche. Cynthia se révèle une femme forte qui défend de belles valeurs : le travail, l’honnêteté, l’amour, la fraternité, la tolérance. C’est un personnage résolument bienveillant qui fait preuve d’une grande intelligence émotionnelle. Quand les gens, dans la rue, me confondent avec Cynthia, je dois leur dire que je suis moins sympathique que mon personnage ! (rire).
Le personnage qui vous a le plus troublée ? Agathe dans Attraction (à revoir sur TF1 en mai 2024), l’histoire d’une femme ordinaire qui est en couple depuis 15 ans. Elle n’a aucune raison de se méfier de son conjoint. Et pourtant… Sur le tournage, les scènes de violences morales et physiques étaient très intenses. Après le bouclage de cette mini-série belge, il m’a véritablement fallu faire le deuil d’Agathe. Pour la petite anecdote : mon compagnon, Geert Van Rampelberg, était pressenti pour jouer le mari d’Agathe. Mais la coproduction française lui a préféré un acteur français, Lannick Gautry. Tant mieux, car je n’avais pas envie de prendre le risque d’exporter de la tension dans notre vie. Geert fait néanmoins partie de l’aventure, puisqu’il joue le rôle du procureur.
Y a-t-il assez de passerelles cultu-relles entre les productions francophones et néerlandophones ? Non. à regret. Il y a bien eu la série 1985 sur les tueries du Brabant créée conjointement par la RTBF et la VRT mais la RTBF a choisi de la doubler en français – une hérésie ! – contrairement à la VRT qui l’a diffusée en version originale. Pour ma part, je joue un petit rôle dans une mini-série flamande remarquable, Albatros, du réalisateur Wannes Destoop (prix Europa de la meilleure série télévisée européenne 2021 – nda). Albatros étant le nom d’un camp de perte de poids auquel participent 10 personnes obèses. Je regarde beaucoup de séries flamandes pour savoir ce qui se produit de l’autre côté de la barrière linguistique…
Une série dans laquelle vous n’avez pas joué, à nous recommander ? Tout va bien, avec notamment Virginie Elfira et Sara Giraudeau. Comment une famille ordinaire traverse-elle les peines de la vie, dans ce cas précis le cancer d’une enfant ? C’est souvent drôle voire fantasque, malgré un sujet douloureux. A voir absolument.
Nouveauté ! Dans le téléfilm espa-gnol El Correo, diffusé en avril sur Netflix, vous partagez l’affiche avec Aron Piper, la star espagnole aux 13 millions de followers. Dans ce thriller, ce sex-symbol révélé par la série Elite s’emmourache de votre personnage. Waouh. (Rire). Aron Piper (26 ans – nda) est un grand professionnel et un véritable gentleman. Par chance, il parle anglais ! Car dans la série (coproduite par la Belgique et Netflix – nda), je suis censée avoir vécu plusieurs années au Mexique et parler plusieurs langues. Pour ce téléfilm, j’ai évidemment suivi un coaching en espagnol mais le premier jour de tournage, j’étais complètement larguée. Les Espagnols parlent beaucoup trop vite. Ce n’est vraiment pas facile de jouer dans une autre langue que la sienne. Merci à Aaron d’avoir été extrêmement bienveillant avec moi !
Quel est votre petit secret pour endosser parfaitement un rôle ? L’observation, ma règle de base. Observation de la démarche, de la gestuelle, de la posture, des tics de personnes, que je fais peu à peu miens, en y apportant une petite touche personnelle évidemment.
Et pour sortir d’un rôle ? Je vous révèle mon petit secret : je demande à la maquilleuse d’ajouter des grains de beauté à mes personnages. Cynthia, Agathe, Elisabeth ont toutes un grain de beauté sur le visage. Ces grains de beauté appartiennent à mes personnages et me permettent de maintenir une relation à distance.
Quelles scènes vous mettent particulièrement mal à l’aise ? Les scènes de nudité et de sexe. Dans le jeu d’acteur/trice, j’essaie d’exprimer des émotions sincères, honnêtes, de ne pas tricher. Or, dans les scènes de sexe, on dissimule toujours, on n’éprouve aucun désir, aucun plaisir, et on se sent parfois ridicule.
Qu’aimez-vous dans le jeu d’actrice ? Je me sens à ma place dans ce métier. C’est le meilleur vecteur que j’ai trouvé pour parler du monde qui m’entoure. Ainsi le téléfilm, Elle m’a sauvée, qui entrecroise les histoires vraies de Julie Douib (le personnage de Laura – nda), abattue par arme à feu et celle de Laura Rapp, laissée pour morte par son compagnon. La mort de Julie sera le déclic pour Laura qui va utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre, et c’est l’embrassement. Ce téléfilm fort dans lequel joue également Lio, dénonce les violences faites aux femmes. Il faut raconter l’histoire des féminicides pour sensibiliser un maximum de gens aux violences dont les femmes sont victimes.
Etes-vous désormais bankable ? Oh non, pas encore. Je tourne beaucoup, mais je pourrais travailler davantage si de belles propositions venaient à moi.
Le cinéma préfère-t-il toujours les blondes ? Plus forcément aujourd’hui, malheureusement pour moi. Les blondes et l’homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, n’ont plus le monopole. (Rire). La question de la diversité dans le cinéma a incité les productions à être le reflet de la société, et a notamment permis de donner plus de paroles aux femmes. Je m’en réjouis sincèrement.
STEPHAN VANFLETEREN - « Parce qu’elle est immobile, la photographie apporte la paix de l’esprit »
STEPHAN VANFLETEREN
« Parce qu’elle est immobile, la photographie apporte la paix de l’esprit »
MOTS : SERVANE CALMANT
PHOTOS : STEPHAN VANFLETEREN
Atelier, c’est un huis clos intime où Stephan Vanfleteren, photographe multi récompensé, façonne la lumière du jour. Atelier, c’est également le titre de son nouveau livre, une monographie retraçant 12 ans de création dans son propre studio. Comment ce formidable artiste qui est né et qui a grandi sous un ciel de plomb belge, est-il arrivé à modeler la lumière ? Confidences.
Stephan, vous souvenez-vous de votre première photo ? Non, pas vraiment. Peut-être une photo de mon chat ou des dunes de Ostdunkerque où j’ai grandi. En revanche, je me souviens très bien du jour où mon père m’a offert son appareil photo, un Pentax Spotmatic. Je n’oublierai jamais le son de l’obturateur, envoûtant !
A vos débuts, aviez-vous un photo-graphe de référence ? Je pense à l’Américain Irving Penn pour l’intimité qu’il est parvenu à créer avec son modèle. Intimité que vous mettez également brillamment en lumière … J’ai en effet découvert le travail incommensurable et inégalable d’Irving Penn, pendant mes études. Et il ne m’a jamais quitté. Il reste une source d’inspiration, dans mon travail de photographe et dans la vie. J’ai failli faire le portrait de ce maître intemporel ; malheureusement, il est décédé peu de temps avant notre rencontre.
Comment arrivez-vous à créer ce cadre d’intimité avec vos modèles ? J’aime l’idée d’aller à la rencontre de l’autre et de créer un moment suspendu. Je m’y consacre entièrement, pleinement, avec beaucoup d’empathie également. Les modèles ressentent cet abandon, cette passion, et offrent souvent beaucoup en retour.
Pour Steve McCurry, il est important de photographier le monde tel qu’il est, donc en couleur. Vous, en revanche, vous avez rapidement opté pour une photographie en noir et blanc. Pourquoi ce choix ? La photographie ne montre jamais le monde tel qu’il est. C’est au photographe de choisir ce qu’il veut montrer ou ne pas montrer, et comment il veut le faire. Tel est le paradoxe de la photographie. Photographier, c’est forcément faire un choix. Et un choix, c’est subjectif. N’oubliez jamais que la photographie convertit un monde trimental en un monde bidimensionnel. On y perd beaucoup, mais on y gagne parfois plus. C’est le moyen ultime pour saisir l’immobi-
lité de la vie. Parce qu’elle est immobile, dans un monde dansant, vibrant et fou, une photographie apporte la paix de l’esprit.
Vous êtes né à Courtrai, et vous vivez aujourd’hui à Furnes, près de La Panne. En tant que Belge, un ciel plombé par la grisaille ou la pluie, vous connaissez ! La photographie de Stephan Vanfleteren aurait-elle été différente sous le soleil ? Le soleil est idéal… en vacances. Mais en tant que photographe, je préfère la lumière douce. « Avec un ciel si gris, qu’un canal s’est pendu » : Jacques Brel n’est jamais bien loin !
Vos photos reflètent une certaine mélancolie. Je me trompe ? Je place en effet beaucoup de mélancolie dans la photographie, pour pouvoir ensuite me sentir joyeux et décomplexé de l’être. La photographie me soulage de ma lourdeur mélancolique. C’est une bénédiction qui me permet de fonctionner dans ce monde.
Nouveau tournant dans votre carrière. En 2015, avec la série « Nature morte », vous décidez d’abandonner le monde extérieur pour travailler en atelier. « Atelier », c’est également le titre de votre nouvel ouvrage. Cet atelier, cet espace clos, est devenu le théâtre de nouvelles collections de photos. Parlez-moi de ce lieu et de la lumière envoûtante qui le pénètre… J’ai beaucoup voyagé dans le monde au cours de ma vie, mais depuis la pandémie, je me consacre pleinement à des sujets qui me tiennent à cœur. L’Atelier est l’un d’entre eux. Pour autant, je ne m’enferme pas dans mon petit monde. La grande contradiction, c’est qu’ici, dans le petit espace de mon atelier, je peux observer tout simplement comment la lumière évolue au cours de la journée et comment une saison naît ou prend fin. Quand la lumière, qui se trouve à 500 secondes du soleil, s’installe petit à petit dans mon atelier, c’est merveilleux. La lumière qui tombe contre les murs ou sur le sol est le terminus d’un long voyage. Jamais, je n’ai autant réfléchi à la lumière. Dans cet atelier, je me rends compte que le monde tourne autour du soleil et que nous sommes tout petits dans ce grand cosmos. Un constat qui permet de s’affranchir de son égo !
Comment apprivoisez-vous la lumière entrante ? Au fil des ans, je suis devenu plus habile pour trouver la lumière nécessaire à la réalisation d’un bon portrait. Mais la lumière ne se laisse jamais totalement apprivoiser. Elle reste parfois insaisissable. Tant mieux, car cela permet de ne jamais maîtriser la situation. La lumière du jour n’est pas un danseur classique prévisible mais un fantôme imprévisible.
Ce travail en atelier est-il le fruit d’une certaine maturité ? La maturité n’explique pas tout. Mon principal moteur, c’est l’envie, le désir, la curiosité. J’aime le changement, aller vers l’inconnu, prendre des risques. Je n’aurais pas pu, pas voulu, rester photographe de presse toute ma vie. Parfois, on me demande pourquoi je photographie une feuille séchée dans mon atelier. Ma réponse : car les choses simples sont les plus difficiles à saisir. Dans la vie également, la simplicité est souvent compliquée à atteindre.
Vous sentez-vous plus serein aujourd’hui qu’hier ? Non. Je ne suis plus l’homme que j’étais à 22 ans ; au-
jourd’hui, à 54 ans, j’ai besoin de porter des lunettes et j’ai parfois mal au dos.(rire). J’ai toujours réalisé ce que je souhaitais faire au moment où je le faisais. Aucun regret. Désormais, je travaille moins la vitesse d’obturation, c’est vrai. Je m’adapte, j’évolue. Dans mon travail et dans ma vie.
La série « Nature morte » présente dans votre livre, se rattache à la tradition d’un Rembrandt, notamment … Est-ce une référence pleinement consciente ? Bien sûr, je connais la lumière des vieux maîtres. Pas seulement Rembrandt ou Vermeer, mais aussi Irving Penn ou Paolo Roversi. Cette lumière est universelle et intemporelle. C’est dans cette tradition que je m’inscris. Cette « vieille lumière », elle me fascine et me séduit.
Cette série, « Nature morte » donne à voir des corps d’animaux morts. Quel est votre rapport à la mort ? Je n’ai aucun tabou concernant la mort. Plus nous approchons de la mort, plus nous réalisons que la vie est précieuse, fragile et si extraordinaire. Malheureusement, les gens en prennent souvent conscience lorsqu’ils tombent gravement malades. J’essaie de contourner ce problème et de regarder la mort droit dans les yeux. Mes Natures Mortes ne sont pas une glorification de la mort, au contraire, elles sont un hommage à la vie !
Combien d’heures intenses passez-vous dans votre atelier à attendre une lumière parfaite à vos yeux ? Tant que le modèle dans la lumière le permet. Je suis un chercheur et j’ai un esprit douteur, alors quand on m’offre du temps, je le saisis jusqu’à pleine satisfaction. L’attente n’occasionne aucune lassitude ; en revanche, après la séance photo, la fatigue s’abat sur moi comme un lourd manteau. Bah, cela me permet de bien dormir !
Atelier, le livre, retrace 12 ans de création. Y figurent notamment les séries Nature Morte, Corpus, ainsi que des portraits de personnalités connues du monde de la musique ou du cinéma (Arno, Warren Ellis, Rutger Hauer, Gregory Porter, Mads Mikkelsen, Terry Gilliam, Matthias Schoenaerts, etc.). Une singularité m’intrigue : la main de Nick Cave…Je suis un grand fan de Nick Cave. Je connais un peu Warren Ellis, son ami et âme sœur musicale. Quand Nick Cave est en tournée, il refuse de se laisser photographier. Et c’était le cas. Alors, j’ai demandé à photographier sa seule main droite… « The Red Right Hand » de Cave est emblématique. J’aime les choses atypiques. Un visage parle. Une main aussi. À moi de la saisir avec mon œil et mon objectif.
Y’en aura-t-il une expo en Belgique à l’issue du livre ? Une exposition inti-tulée « Nature morte/Still Life » a lieu à Paris, à la Galerie Rabouan Moussion, jusqu’au 31 décembre. En Belgique, rien n’est encore prévu. Si quelqu’un connaît un espace d’expo formidable en Wallonie ou à Bruxelles, qu’il n’hésite pas à m’appeler. Expo et livre dégagent deux énergies différentes. Le livre a sa propre vie, il se suffit à lui-même. Je crois en la puissance des pages, au rythme propre au livre, à l’intensité au coeur de la relation auteur-lecteur.
Atelier, monographie,
Editions Hannibal Books
Dani Klein - « Je ne suis absolument pas nostalgique des années Vaya Con Dios »
Dani Klein
« Je ne suis absolument pas nostalgique des années Vaya Con Dios »
Mots : Servane Calmant
Photos : Dirk Alexander
Après près de 10 ans d’absence, le groupe belge Vaya Con Dios opère un retour en charme avec « Shades of Joy », nouvel album lumineux nourri de soul, de jazz, de consonances hispaniques et porté par la voix de velours de Dani Klein, la chanteuse. Comme au bon vieux temps ? Confidences.
« Just a friend of mine », « What’s a woman », « Nah neh nah », « Puerto Rico », des tubes à la pelle ! Vaya Con Dios, composé initialement de la chanteuse Dani Klein, du batteur Marc De Meersman, du guitariste Willy Lambregt et du bassiste Dirk Schoufs, a marqué les années 80-90. Pour autant, l’aventure musicale du groupe s’arrête en 2014, après un concert mémorable à Forest National, à Bruxelles. 2020, la pandémie arrive sans prévenir. Le monde est à l’arrêt. La Belgique autorise une bulle de réunion de trois personnes. Ca tombe bien, ils sont trois amis à se tourner les pouces : Dani Klein, le guitariste Thierry Plas (ex Machiavel ) et François Garny ( bassiste d’Arno pendant des années, il a également accompagné Adamo, Philip Catherine, Bernard Lavilliers, Jacques Higelin, …). Dans le studio de Thierry, ils se mettent à écrire de nouvelles chansons et de nouveaux arrangements. Onze titres qui vont composer un nouvel album : « Shades of Joy ».
Vous aviez annoncé la fin du groupe en 2014. Ce nouvel album, « Shades of Joy », a-t-il un parfum de nostalgie particulier ? Oh non, pas du tout. Je ne suis absolument pas nostalgique des années Vaya Con Dios. Ce qui est fait est fait : j’ai toujours préféré regarder devant que derrière. Ce nouvel album trouve en fait sa genèse dans le confinement. J’étais coincée à Bruxelles, sans pouvoir rentrer en Andalousie. Je m’ennuyais terriblement. Alors, pour tuer le temps, moi, François (Garny – ndlr) qui ne partait plus en tournée à cause de la pandémie et Thierry (Plas – ndlr) dont le studio était à l’arrêt forcé également, nous avons décidé de faire de la musique. Cet album a donc été conçu spontanément, sans aucun plan derrière la tête, aucune intention préconçue, aucune contrainte artistique, sans limite de temps ni de budget. On se voyait uniquement pour le plaisir, pour de passer de bons moments en composant ensemble de nouveaux morceaux. Le studio de Thierry était devenu une sorte de laboratoire créatif. C’était très inspirant de pouvoir travailler avec autant de liberté.
Riche de consonances jazzy et hispaniques, « Shades of Joy » sonne pourtant 100% Vaya Con Dios. Comme au bon vieux temps, si j’ose dire. Oui, car j’ai toujours fonctionné ainsi. J’écoute beaucoup de musique différentes, qui toutes m’ont influencée et nourrie.
Votre voix est toujours aussi envoûtante ! Et on dit que la voix est le reflet de l’âme… Dani Klein est-elle toujours la femme qu’on a connue dans les années 80 ? Je vais citer la chanteuse Barbara : « J’ai changé, sachez-le, mais je suis toujours comme avant ». Avec le temps, je suis probablement un peu plus sage, je m’accepte mieux également. Mais mon tempérament assez direct est resté le même.
Sur« Shades of joy », vous dites qu’une bouche meurtrie ne vaut rien et sur « Kissing slow », qu’il faut célébrer chaque nuance de joie. Je vous trouve bien optimiste, car à l’époque de la conception de l’album, nous ne savions pas de quoi serait fait demain ! Et nous ne le savons toujours pas ! (Elle rit). C’est même pire. Les guerres, une société déshumanisée, robotisée. J’ai donc fait le pari, oui, d’un peu de légèreté et d’optimisme.
La musique comme thérapie ? Oui, sans être capable de résoudre tous les maux de la terre, la musique permet à tout le moins de s’évader.
Vous avez marqué les années 80-90, vendu des millions d’albums. Pour autant, vous avez toujours été discrète. Que vous inspire le vedettariat ? Je déteste le star system ! Le culte des stars est lié à un mécanisme de projection des désirs du public sur la star, qu’elle se doit ensuite d’entretenir pour ne pas décevoir ses fans. Mais qui est réellement l’homme ou la femme derrière la star adulée ? Ce rapport star-public est le plus souvent faux. Et je déteste le faux. Je plaide pour la vraie valeur humaine, pas pour le vedettariat. Aujourd’hui, on déconstruit des mythes, comme Picasso par exemple, dont le talent occultait une face cachée, un homme violent. Cette déconstruction est salutaire.
Dani, vous avez fait beaucoup de retour entre Bruxelles et l’Espagne. Où habitez-vous aujourd’hui ? Depuis la Covid, j’ai vendu ma maison en Espagne, et je me suis définitivement installée à Bruxelles.
L’album « Shade of Joy » est dans les bacs des disquaires, nous nous attendons donc tout logiquement à une tournée. Est-elle déjà fixée ? Très sincèrement, je ne sais pas si nous ferons du live. C’est lourd à gérer, une tournée ! Ai-je encore le courage de me lancer dans pareille aventure ? Je n’en sais rien. A tout vous dire : on hésite. (Affaire à suivre – ndlr)
Delphine Girard « Naïvement, j’ai toujours cru que la justice pénale avait pour mission, la réparation. »
Delphine Girard
« Naïvement, j’ai toujours cru que la justice pénale avait pour mission, la réparation. »
Mots : Servane Calmant
Photo : Maurine Toussaint
Quelle trajectoire judiciaire pour la victime d’un viol en Belgique ? Et pour l’agresseur ? Et le témoin ? Ce sont les questions volontiers pertinentes formulées par notre compatriote Delphine Girard dans « Quitter la nuit », l’un des films belges les plus attendus de 2024. Rencontre.
Une nuit, dans une voiture, la tension est à son comble. Un homme menace une femme qui dit appeler sa sœur. C’est ce qu’elle fait croire à l’homme, car au bout du portable, c’est une opératrice d’appel d’urgence qui a décroché, qui écoute sa détresse et lui vient en aide. L’homme, agresseur présumé, est arrêté puis remis en liberté. La justice cherche des preuves tangibles…Une victime, un agresseur, un témoin auditif : pendant deux ans, ces trois personnes vont faire face aux échos d’une nuit qu’ils ne parviennent pas à quitter …
« Quitter la nuit », votre premier long-métrage, prolonge le récit de « Une sœur », un film de quinze minutes qui était en lice pour l’Oscar du Meilleur court-métrage en 2020. Ce n’est pas banal comme démarche… Le court-métrage fonctionne comme un thriller psychologique en temps réel et explore la sororité entre la victime et l’opératrice d’appel. Mais le court-métrage terminé, les personnages ont continué à m’accompagner, à m’habiter. Qu’allaient-ils leur arriver après le drame ? Quel allait être le parcours judiciaire de la victime ? Et celui de l’agresseur ? Comment la témoin allait-elle réagir ? Toutes ces questions qui m’ont grandement interpellée, ont été le moteur du long-métrage.
Pour ce long-métrage, vous avez fait appel aux mêmes interprètes : Selma Alaoui la victime, Veerle Baetens l’opératrice, Guillaume Duhesme l’agresseur… Nous avions noué des liens solides pendant le tournage et la promotion du court-métrage, il me semblait donc naturel de revenir vers eux. Naturel mais inattendu, car jamais je ne leur avais parlé de ce projet de long, même si la matière de « Quitter la nuit » faisait écho à des discussions que nous avions eues entre nous, au moment de la préparation du court.
Vous êtes-vous beaucoup documentée pour écrire le scénario ? J’ai rencontré des policiers, des médecins, des avocats, j’ai assisté à des procès pour viol. Je souhaitais me faire ma propre opinion de la justice, comprendre ce qu’il advient des victimes et des agresseurs dans le cadre de procédures pénales.
La justice ressemble à un parcours semé d’obstacles. Au traumatisme du viol, succèdent le traumatisme de l’interrogatoire et la lenteur d’un système judiciaire qui cherche des preuves. « Moi, je vous crois », confie une agente de police à la victime du viol, « mais pour la justice, ce n’est pas tangible. » Cette phrase, elle est terrible ! Nombreuses sont les victimes qui décident de ne pas porter plainte contre leur agresseur car elles savent qu’elles ne pourront pas apporter à la justice les preuves tangibles réclamées. La lenteur de la justice décourage également plus d’une personne. Imaginez-vous la frustration et la solitude que ces victimes ressentent ! Naïvement, j’ai toujours cru que la justice pénale avait pour mission, la réparation. Or son véritable objectif est de faire appliquer des textes de loi et de punir. Mais que fait-elle pour la victime ? En tant que cinéaste, je questionne, j’interroge le système judiciaire belge : la peur de l’enfermement carcéral ne pousse-t-elle pas l’agresseur à taire les faits ? L’agresseur n’a-t-il pas intérêt à noircir la victime pour éviter l’incarcération ? Or, cette reconnaissance du viol par l’agresseur est nécessaire. J’en déduis donc que le système judiciaire ne répond pas aux besoins de la victime qui a principalement besoin de se sentir écoutée, sans jugement aucun.
En Belgique, la réforme du droit pénal sexuel de 2022 a inscrit la notion de consentement dans la loi. Consentement et contrainte, sont au coeur de « Quitter la nuit ». Il est clair pour moi qu’il y a absence de consentement entre la femme et l’homme. Il y a contrainte et agression sexuelle. Mon récit est exempt de toute ambiguïté à ce sujet. Pourtant, lors des projections du film, il est apparu que certains spectateurs n’avaient pas la même lecture que moi. C’est un fait très intéressant car il parle de la perception que chacun, chacune, a de la notion de consentement. Où, chacun, place-t-il les limites du consentement ? Où débute la contrainte ?
Votre récit est triplement intéressant, si j’ose dire, car vous explorez trois destins sur le long terme… J’ai cherché à éviter tout manichéisme. Je ne voulais pas d’un agresseur qui fasse figure de monstre, ni d’une victime angélique. Quant au personnage de l’opératrice d’appel d’urgence, elle fait partie de l’institution judiciaire et sent qu’elle a un rôle à jouer. Parce qu’elle a été touchée par le témoignage de la victime.
« Quitter la nuit » s’est baladé de festival en festival, Venise (où il a été couronné du Prix du public), Saint-Jean-de-Luz, Les Arcs, Montréal, Saint-Sébastien, Namur, Ostende … Avez-vous déjà un nouveau projet en tête ? Le monde bouge vite, beaucoup, douloureusement. Je me laisse le temps de réfléchir, de trouver un sujet qui a du sens à mes yeux. Faire du cinéma exige beaucoup d’investissement personnel, je ne souhaite pas me précipiter…
Joachim Lafosse
Joachim Lafosse
« Ils sont nombreux les spectateurs qui vont au cinéma pour explorer leurs propres affects »
Mots : Servane Calmant
Photo : Kris Dewitte
En auscultant la dimension tragique de l’Affaire Hissel, le réalisateur belge Joachim Lafosse sonde la honte et le silence qui ont conduit une mère à se taire et un fils à vouloir tuer son père. « Un silence », en salle le 24 janvier 2024, a d’ores et déjà été couronné par le prix du Meilleur réalisateur au Festival de Rome.
Astrid (Emmanuelle Devos), l’épouse d’un célèbre avocat (Daniel Auteuil), voit son équilibre familial s’effondrer lorsque leur fille décide de révéler un secret enfoui depuis 25 ans, au cœur de leur maison bourgeoise provinciale. Rendus publics, les comportements déviants du père vont bouleverser leur fils, 18 ans. Le drame est inéluctable…
L’Affaire Hissel a défrayé la chronique en Belgique. L’ex-avocat hyper médiatisé des familles de Julie et Mélissa a été poignardé par son fils, puis condamné pour détention illégale d’images pédopornographiques… Ce qui vous intéresse dans ce fait divers, ce ne sont pas les actes mais la trajectoire qui a poussé un ado à vouloir tuer son père. Oui, je ne prétends pas détenir la vérité concernant l’Affaire Hissel, dont je ne connais pas personnellement les protagonistes. « Un silence » n’est pas un récit documentaire objectif. Je revendique la fiction. Et avec ce récit fictionnel, je parle de mon rapport, celui de Joachim Lafosse, à la honte qui engendre le silence.
Pourquoi dès lors s’inspirer d’un fait divers ? Parce que les faits rapportés, notamment par la presse, m’ont ému. Et c’est parce qu’ils m’ont touché, que je sens qu’il y a matière à écrire une œuvre de fiction. Je ne rapporte pas juste les faits mais je tente, par la fiction, j’insiste, d’emmener le spectateur avec moi dans une réflexion et une émotion, qui vont lui permettre de penser, de ressentir, pourquoi le fils, cet adolescent de 18 ans, est passé à l’acte, en poignardant son père à plusieurs reprises. Pourquoi le quotidien de cette famille bascule vers la tragédie, voilà ce qui m’intéresse. On ne le dit jamais assez mais chaque film (ou roman) est écrit par deux auteurs/autrices : le scénariste, puis chaque spectateur qui fait sien le film à travers sa propre perception de l’œuvre. C’est pour que le spectateur s’inscrive, à travers sa propre histoire, dans la fiction, que je suis devenu réalisateur. C’est à mon sens, ce qu’on attend d’une création, d’une œuvre d’art.
Pourquoi la mère a-t-elle gardé le silence pendant 15 ans ? Parce que la honte engendre le silence. Nous avons toutes et tous ressenti, un jour, dans notre vie, ce sentiment de honte, de culpabilité ensuite, et nous nous sommes pourtant tus. Astrid, la mère, vit sous l’emprise de son mari, puissant patriarche, qui ne ménage pas ses efforts pour garder son masque. On ne peut pas obliger les gens à parler. Mais aujourd’hui, la parole se libère, c’est pour cette raison que la fille d’Astrid demande que justice soit faite. La génération actuelle ose enfin parler.
Emmanuelle Devos et Daniel Auteuil ont-ils d’emblée accepté le scénario ? Emmanuelle Devos est une actrice très exigeante, j’ai retravaillé le scénario pour elle, ce qui m’a rassuré car ça signifiait qu’elle m’accompagnait dans un même souci de justesse. Daniel Auteuil n’était pas mon premier choix. De nombreu-ses grandes stars du cinéma français ont refusé de porter ce personnage. à la lecture du scénario, Daniel Auteuil a, en revanche, tout de suite accepté.
Pourquoi ont-ils refusé ? Par peur d’endosser le rôle d’un avocat chevalier blanc qui apparaît à son tour et à titre personnel dans une enquête pour des faits de pédophilie. Plusieurs m’ont dit : le scénario est remarquable, mais…
« Un silence » est une tragédie humaine, à l’instar de vos autres films, « Elève libre », « A perdre la raison » (inspiré de l’affaire Geneviève Lhermitte), … J’ai souvent entendu dire : Joachim Lafosse aime les histoires tordues. Non ! En tant qu’auteur, je suis avant tout ému par un drame. Comment un ado peut-il être dans une détresse si puissante qu’elle l’amène à vouloir tuer son père (« Un silence ») ? Qu’est-ce qui pousse une femme à tuer ses 5 enfants (« A perdre la raison ») ? Je suis également touché par les conflits conjugaux dans « L’économie du couple », par la relation entre un ado en décrochage scolaire et un adulte qui veut le sauver dans « Elève libre ». où j’interroge le passage de la transmission à la transgression.
Des films qui font réfléchir, qui invitent à débattre … Je suis l’un des auteurs belges qui fait le plus d’entrées en France, autour de 200 000 entrées par film, depuis plusieurs années. Donc oui, ils sont nombreux les spectateurs qui vont au cinéma pour penser leur vie et explorer leurs propres affects. Et il faut le dire, et l’écrire.
Pour « Un silence », vous venez de recevoir le Prix du meilleur réalisateur au Festival de Rome. Ces prix, à l’instar des Magritte, boostent-ils la fréquentation du film en salle ? Oui, cela aide sans doute un peu. Moi, j’ai toujours regardé les autres cinéastes belges aller chercher leur Magritte. A ce jour, je n’en ai reçu qu’un pour « A perdre la raison ». à croire que les Magritte n’apprécient pas mes films …
« Un silence » sortira chez nous le 24 janvier. Etes-vous déjà sur un autre projet ? Je tourne au mois d’avril mon prochain long-métrage, avec Guslagie Malanda (formidable dans « Saint Omer », ndlr) et deux préadolescents de 11 ans.
Un silence, en salle le 24 janvier.
Philippe Geluck - Le Belge derrière le Chat
Philippe Geluck
Le Belge derrière le Chat
MOTS : SERVANE CALMANT
PHOTOS : ANTHONY DEHEZ
MAKE-UP ARTIST : LUC DEPIERREUX
Double actu pour Philippe Geluck avec la sortie de la BD, « Le Chat et les 40 bougies », et l’expo « Le Chat déambule » qui joue les prolongations au Parc royal de Bruxelles. Au fait, le Chat aurait-il pu être un lapin ? Qui de Geluck ou du Chat est-il le moins consensuel ? Qui a déjà fait taire Le Chat ? Le musée du Chat, est-ce comme le RER, un mirage lointain ? Notre invité, auteur prolifique de dessins d’humour, comédien, homme de radio et de télévision, entrepreneur aussi, se confie.
À 16 ans, votre premier dessin publié. à 18 ans, votre première expo. Philippe, vous êtes un précoce ! Ado, avez-vous emballé des filles avec vos dessins d’humour ? à 14 ans, je portais des lunettes de la mutuelle et j’avais les cheveux gras… Quand j’ai commencé à séduire les filles, mes dessins leur plaisaient : je les faisais rire. Mais rien n’a changé, tous les jours, je fais rire Dany, mon épouse.
Votre père était dessinateur de presse sous le pseudonyme de Diluck. Votre mère, soprano. Ils se sont rencontrés en faisant du théâtre amateur. Leur devez-vous beaucoup ? Quand maman était enceinte, elle se massait le ventre en pensant : pourvu que mes enfants deviennent des artistes. Je leur dois énormément, parce qu’ils m’ont ouvert les yeux sur l’art. Si mon frère aîné et moi avions voulu être avocat ou comptable, nos parents ne nous auraient plus adressé la parole ! (rire)
Le dessin d’humour devient donc très vite une évidence … Oh oui ! Mon fantasme n’a jamais été de devenir dessinateur de BD mais dessinateur d’humour. Mes références étaient et sont toujours : Sempé, Siné, Reiser, Wolinski, Steinberg …
Pourquoi un chat et pas un chien ou un lapin ? Vous allez rire : pour le faire-part de mon mariage, j’avais fait des croquis préparatoires. J’avais d’abord dessiné deux lapins, puis deux chiens, puis deux chats. Fondamentalement, je me sens plus chat que chien : même indépendance. Et si on me lance une baballe, jamais je n’irai la chercher !
Ce faire-part de mariage, vous venez de me le montrer : le chat a déjà un gros nez. Pourquoi ? Je ne sais pas, je vous le jure ! Beaucoup de dessinateurs de BD vous répondront la même chose : on ne se rend pas toujours compte de ce que l’on dessine. Nous le faisons instinctivement, puis le personnage évolue d’année en année, et il acquiert progressivement une forme plus ou moins définitive.
Il a du pif ce Chat, donc… Ah ah, c’est peut-être en effet un hommage sublimi-nal à Pif le chien … Le Chat a du flair et surtout, il nous regarde : c’est ça l’essentiel. Il est le miroir de nos travers et des absurdités du monde.
Le Chat est belge, il n’est pourtant pas empreint de belgitude… C’est vrai, Dans La Minute du Chat, la série animée, le Chat n’a pas l’accent belge. Mais si je n’étais pas né en Belgique, Le Chat aurait été probablement différent.
Vous êtes le papa du Chat, du Fils du Chat (à destination des enfants) mais aussi de Geluck se lâche, de Geluck enfonce le clou… Le Chat est-il plus consensuel que Philippe ? Je suis plus con et lui plus sensuel, qui sait ? (rire). Le Chat est plus bonhomme, plus familial. Il est apparu la première fois, en 1993, dans le quotidien Le Soir… Avec Le Chat, je me suis apaisé, en effet. Mais quand Siné m’appelle pour Siné Hebdo, je me lâche davantage. Casterman en publiera un recueil où j’avertis d’ailleurs le lecteur qu’il va découvrir des textes et des dessins impolis…
Le Chat a 40 ans. 40 ans de liberté ? Combien de fois a-t-il été censuré ? Trois fois. Un dessin sur les risques de rouler à moto n’a pas été publié dans Le Soir, car le journal avait un gros annonceur moto. Un dessin d’un sexe entre deux siamois ; motif invoqué : pas de zizi dans Le Soir. Et un dessin dans VSD au moment de l’affaire DSK : Le Chat tenait un journal sur lequel j’avais écrit « Le coup de bite qui a changé l’histoire de France ». (rire)
Et Philippe, il se contient parfois ou souvent ? Je récuse l’idée selon laquelle je pourrais m’autocensurer à cause de l’époque ou de la peur. Le seul tabou reste la représentation de Mahomet. Ceux qui l’ont fait l’ont payé de leur vie et plus aucun dessinateur depuis n’ose le faire. Par contre, je continue à parler des religions, à dessi-ner les intégristes et la burqa. Et je continuerai à le faire.
Qu’est-ce qui fâche parfois le lecteur ? Depuis le début, Dieu, toute croyance confondue. Aux lettres qui me reprochent son évocation, je réponds : si Dieu nous a créés, il m’a créé aussi, doté du sens de l’humour. Je n’ai jamais reçu de menaces, par contre, j’ai récolté des milliers de remerciements et notamment de la communauté musulmane. En Belgique et en France, il n’y a pas de répression du blasphème, mais ce droit au blasphème va de pair avec un devoir de respect, ne l’oublions pas.
Lollipop, L’Esprit de famille, La Semaine infernale, le Jeu des dictionnaires… Vous avez marqué la télé et la radio belges des années 80. Ah, les années 80… C’était mieux avant ? Avant, nous étions plus jeunes mais vieux, c’est pas mal non plus ! Avant, nous avions l’impression que la démocratie se portait bien ; aujourd’hui, la montée des nationalismes la fragilise. Je regrette l’appétence culturelle d’hier et la déculturation actuelle sous l’influence des réseaux.
Depuis 1990, vous travaillez avec le même coloriste, Serge Dehaes. Etes-vous un homme particulièrement fidèle ? Et comment ! Je viens de fêter 47 ans de vie commune avec Dany, mon épouse. Fidèle, c’est un joli mot. Je suis fidèle à mon Chat, à mes amis – dans la bande à Ruquier, je suis le plus ancien -, à mes opinions, à mes engagements. J’ai pu abandonner des projets mais jamais des personnes. Patrick Chaboud (le créateur et animateur de la marionnette Malvira – ndlr) est un ami pour la vie.
Comment trouvez-vous vos gags ? Debout, assis, en marchant, au soleil ou sous la pluie. Mais si je ne saisis pas le gag dans un petit carnet ou sur mon smartphone, il s’envole. Deuxième méthode de travail : je m’assois devant une feuille blanche et j’attends 2’30 avant d’avoir une première idée, rarement plus.
Vous n’avez pas de mode d’emploi ? Non, mes gags sont toujours intuitifs.
Avec Le Chat déambule, vous investissez l’espace public avec des sculptures monumentales de Chats en bronze. La folie des grandeurs ? Non, une nécess ité ! Le projet d’un musée du Chat été lancé en 2012. J’ai alors commencé à réunir des sponsors privés, mais deux d’entre eux, et non des moindres, m’ont laissé tomber. J’ai donc cherché un moyen d’alimenter la cagnotte qui servira à aménager le musée du Chat. J’ai imaginé des sculptures monumentales de Chats en bronze, la fonderie Van Geert d’Alost a joué le jeu, et j’ai annoncé leur mise en vente : 27 ont trouvé acquéreurs, 18 sont toujours exposées au Parc royal de Bruxelles.
Pour terminer : une réalité qui fâche ! Evoqué en 2014, prévu en 2024, le musée du Chat est retardé à 2026… Pour faire court : la Région bruxelloise construit un nouveau bâtiment dont elle sera propriétaire, le musée du Chat lui paiera un loyer et financera les aménagements. Ce musée du Chat sera en réalité un musée du Chat et du dessin d’humour, avec des expositions temporaires consacrées aux grands noms du secteur, Sempé, Siné, Kroll, Chaval… J’ai visité le chantier fin novembre, il est à nouveau à l’arrêt. C’est insupportable, d’autant que je ne sens malheureusement pas de réelle volonté politique derrière le projet…
BD « Le Chat et les 40 bougies », Casterman Editions
Expo « Le Chat déambule », au Parc royal de Bruxelles, jusque février 2024.
Sophie Breyer - « Les prix remis au cours des festivals ne racontent pas la réalité du métier d’actrice »
Sophie Breyer
« Les prix remis au cours des festivals ne racontent pas la réalité du métier d’actrice »
MOTS : SERVANE CALMANT
PHOTOS : ANTHONY DEHEZ
Elle joue dans les séries belges à succès, « La Trève » et « Baraki ». Crève l’écran dans « La Ruche » où son intense interprétation lui vaut d’être récompensée aux festivals de Mons et de Rome, et aux Magritte en tant que « Meilleur espoir féminin ». Sophie Breyer, Liégeoise d’origine et de cœur, est l’étoile montante du cinéma belge. Le ressent-elle comme une pression ? On lui a posé la question.
C’est par la porte du court-métrage que vous entrez dans le grand monde du cinéma. Vous enchaînez ensuite avec les séries à succès : « La Trêve » (drame policier »), Laëtitia (mini-série dramatique) et « Baraki » (comédie loufoque). Dans quel registre vous sentez-vous le mieux ? Je prends du plaisir à jouer les drames comme les comédies. Les meilleurs films sont probablement les drames qui arrachent un sourire et les comédies qui font pleurer. Pour peu évidemment que les franches comédies se dégagent des stéréotypes et véhiculent un propos neuf…
Quel type de rôle pour vous séduire ? Un personnage complexe avec ses failles et ses contradictions, autant de facettes intéressantes à travailler au jeu. L’autre critère : le défi, la nouveauté. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté « Baraki », ma première comédie.
« La ruche », huis clos dans l’intimité d’une fratrie et d’une mère bipolaire, est un moment clé dans votre jeune carrière. Votre interprétation intériorisée vous vaut plusieurs récompenses, notamment aux Magritte. Ce Prix du meilleur espoir féminin vous met-il la pression ? Absolument pas. Car il y a un monde entre ce genre de cérémonie, ces prix et le quotidien d’une actrice. Un gap qui ne rend pas compte de l’attente, des désillusions, des moments de creux, de vide. Le public aime bien ces récompenses, car il imagine pour la lauréate un tracé de vie linéaire, et ce n’est absolument pas le cas.
On imagine volontiers qu’après ce Magritte, vous auriez croulé sous les scénarios… Et ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, j’ai un champ libre devant moi. Ce prix d’interprétation n’a eu aucun impact sur ma vie professionnelle. La charge symbolique des Magritte n’est pas celle des César ! Je comprends néanmoins l’importance de cette symbolique des prix, quand elle s’accompagne d’actes. Ainsi les films lauréats qui ressortent en salle après la cérémonie : leur accorder une nouvelle visibilité est évidemment louable. Jouer, c’est un formidable métier : j’aime me mettre au service d’un projet, me laisser guider, mais cela m’oblige à dépendre du désir des autres. Or, je suis une personne qui a l’esprit d’initiative, j’ai besoin de me nourrir d’autre chose.
Dites-nous tout… Un défi d’écriture me titille. Voire de réalisation. J’aime cette idée d’avoir la maîtrise d’un projet.
« La ruche » est un film de comédiennes. Est-ce ce cinéma d’auteur aux scénarios non formatés, que vous avez à cœur de défendre ? Oui. Sans hésitation. Le tournage de « La Ruche » a été exceptionnel. Tout un dispositif a été pensé en amont du tournage, pour que le jeu des comédiennes soit au centre du film. Avoir autant de liberté, un terrain de jeu sans limite, était inespéré.
Quel regard portez-vous sur le cinéma belge ? C’est un cinéma riche car extrêmement varié. On ne peut plus le résumer au réalisme poétique, à l’ultra-réalisme ou aux films sociaux, car il est moins typé qu’avant. De jeunes réalisateurs sont venus l’enrichir avec d’autres thèmes, d’autres codes, d’autres genres comme le thriller.
Avez-vous vu Barbie ? (Rire). Oui, et je n’ai pas boudé mon plaisir. Cependant, c’est seulement un divertissement destiné au grand public, il ne faut pas compter sur moi pour l’intellectualiser et y voir une charge politique contre le patriarcat. Barbie est un film Mattel créé pour faire vendre d’autres produits, ne l’oublions pas.
Quelle actrice vous touche particulièrement ? Plus que les actrices, ce sont les personnages et les parcours qui retiennent mon attention. Ainsi Adèle Haenel que j’apprécie particulièrement pour l’étendue de son registre, pour son talent et son militantisme.
Un militantisme que vous partagez ? Quand Adèle Haenel décide de politiser son arrêt du cinéma pour notamment dénoncer un Festival de Cannes écoci-daire et un milieu gangréné par les agresseurs sexuels, elle n’est clairement pas à côté de la plaque ! Heureusement, les mentalités évoluent. Aujourd’hui, on réfléchit à moins impacter la nature lors de scènes en extérieur, on prévoit la présence de référents harcèlement sexuel sur les tournages, on fait également de la prévention en présentant des chartes qui condamnent les comportements homophobes, grossophobes, racistes, etc. Je suis particulièrement sensible à cette évolution, pour que chacun se sente bien sur un plateau de tournage.
Quelle est votre actu ? Et vos projets pour 2024 ? Je viens d’achever le tournage de « Discordia » du réalisateur belge Mathieu Reynaert. La saison 2 de « Baraki » débarque à la rentrée sur Tipik et Auvio. La saison 1 est toujours disponible sur Auvio. Côté projet : j’ai coréalisé avec Flore Mercier et Angèle Bardoux , un docu-fiction de 30 minutes, réalisé dans le cadre d’un atelier avec l’association « Vie féminine » et des mères qui ont perdu la garde de leurs enfants. Il faut désormais en assurer la diffusion pour porter la voix de ces mamans. C’est un projet qui me tient particulièrement à cœur.
ALEX VIZOREK : « L’idéal, c’est de pratiquer l’humour potache sans jamais prendre les gens pour des cons »
ALEX VIZOREK
« L’idéal, c’est de pratiquer l’humour potache sans jamais prendre les gens pour des cons »
MOTS : SERVANE CALMANT PHOTO : GILLES COULON
Notre compatriote Alex Vizorek est un artiste inclassable. Stand-upper inspiré, humoriste philosophe, chroniqueur pertinent, auteur surprenant, il sera également aux commandes d’un nouveau talk-show télévisé sur France 2 le 5 novembre 2023.. Avec un pied à Paris, un pied à Bruxelles,
Alex l’infatigable marche droit devant.
Vous partagez votre temps entre Paris et Bruxelles. Dans quelle ville vous sentez-vous vraiment chez vous ? Je me sens profondément belge. Je ressens ce sentiment universellement répandu d’appartenir au pays de ma naissance. Et ce pays, c’est la Belgique, indiscutablement. Mais j’habite également Paris depuis 15 ans et ce n’est pas un lieu de passage. J’y ai mes amis, mon travail, mes habitudes. Je ne pourrais plus choisir entre Bruxelles et Paris. Voyager entre les deux me convient parfaitement. D’autant que je suis doublement chanceux : Paris m’a accepté et, parallèlement, je suis toujours considéré comme un Belge en Belgique. Je ne suis pas un exilé qui ne sait plus d’où il vient.
En 2023, les Belges continuent à dire qu’ils « montent à Paris ». Or, géographiquement parlant, nous « descendons à Paris ». Ce provincialisme, il vous agace ? Il y a un côté pyramidal dans la réussite artistique dont le sommet s’appelle Paris. Cette logique parisienne, je la vis au quotidien et je fais tout pour la combattre, car je suis pire qu’un provincial, je suis un étranger !
Un étranger qui a sacrément bien réussi. Merci. Gamin, déjà, j’estimais que Paris était l’aboutissement de la réussite. Mes parents avaient programmé les chaines de télévision françaises avant les chaines nationales, ça vous forge un homme. J’ai toujours été influencé par Paris, même s’il me faut gérer le stress de la ville. En Belgique, il y a un côté plus plan-plan, qui n’en est pas moins agréable. Par chance, mon succès parisien rejaillit sur mon pays.
La condescendance parisienne envers le Belge, est-ce de l’histoire ancienne ? L’époque de l’assimilation forcée où Annie Cordy et Brel étaient considérés comme Français, est révolue. Le Belge est réputé sympa, grâce notamment à Geluck et Poelvoorde. Les artistes belges qui sont venus après, Damiens, Elfira, moi, et beaucoup d’autres, ont pu profiter de ce changement d’attitude des Parisiens envers les Belges. Désormais, nous sommes considérés comme cool et exotiques.
« Télématin » sur France 2 en radio, « En bande organisée », un nouveau talk-show sur France 2 en TV et « RTL Soir » sur les ondes de RTL France (à écouter sur le web). Vous êtes carrément devenu l’un des princes du PAF français ! A l’annonce de mon départ de France Inter et sa matinale pour rejoin- dre RTL France, j’ai reçu beaucoup de réactions, positives comme négatives. Ce départ « passionnait » les auditeurs, au-delà de mon seul cercle familial. De toute évidence, en treize années sur les ondes françaises, j’ai réussi à me faire un petit nom… Cela m’a fait plaisir.
A quoi doit-on s’attendre avec « En bande organisée » ? Deux humoristes, Philippe Caverivière et moi, seront aux commandes d’un talk-show humoristique produit par Arthur et diffusé tous les dimanches après-midi sur France 2.. Nous accueillerons des invités et d’autres humoristes spécialistes du stand-up. Cette émission est née du constat qu’il n’y avait plus de programme humoristique en France. En Belgique, il y a « Le Grand Cactus » …
Vous nous avez concocté un « Grand Cactus » à la française ? Non, l’esprit 100% potache du « Grand Cactus » n’est pas adaptable en France. Il y aura du potache dans « En bande organisée » mais en alternance avec un humour plus incisif, plus poil à gratter. J’espère que nous trouverons la bonne recette !
Artiste résolument inclassable, vous avez encore eu récemment une bonne idée : raconter « L’histoire d’un suppositoire qui voulait échapper à sa destinée ». Vous auriez pu en faire un sketch radiophonique, mais non, vous nous avez concocté un livre illustré pour enfants et pour adultes… J’ai adoré traduire cette idée loufoque en un récit illustré. Au début, personne n’en voulait. Puis, j’ai rencontré une éditrice aussi barrée que moi. La BD a cartonné. Tant, que je lui donne une suite qui sortira le 17 octobre prochain et s’intitulera « L’histoire du suppositoire qui visait la lune », aux éditions Michel Lafon Jeunesse.
Vous êtes un véritable philosophe …
(Rire) Le véritable Alex Vizorek est aussi potache que nietzschéen. L’idéal, c’est de pratiquer l’humour potache sans jamais prendre les gens pour des cons.
Avoir de bonnes idées : une excellente manière de résumer votre métier … Exactement. Trouver une idée, la rendre drôle, et choisir le bon moyen de l’exprimer.
Alex, on vous voit tout prochainement en Belgique avec votre spectacle « Ad Vitam » et on vous croise au Petit Kings ! Je reviens en effet sur mes terres d’origine avec mon dernier spectacle pour de nouvelles dates (à Auderghem, Wavre, Mons, Spa … nda). Et, le 1er septembre dernier, avec l’équipe du Kings of Comedy Club, on a en effet ouvert « Le petit Kings » à Saint- Gilles. C’est le petit frère du « Kings » à Ixelles. Offrir à de jeunes talents un lieu bruxellois où s’exprimer, avant de s’exporter, à Paris, qui sait ?, me tenait particulièrement à coeur.
Les explorations exaltantes d’ ISABELLE WÉRY
Les explorations exaltantes d’ISABELLE WÉRY
MOTS : BARBARA WESOLY
PHOTO : LAETITIA BICA
Elle se joue des étiquettes, baladant sa fantaisie au gré des planches comme des écrits, parmi lesquels Rouge Western, son dernier roman. Si Isabelle Wéry n’aime rien plus que les récits qui emportent vers des ailleurs entre réalité et imaginaire, elle est aussi une voyageuse exaltée par sa découverte du monde.
Tout comme votre dernier livre, Rouge Western, cette interview revêt elle aussi une dose de surréalisme, puisque vous vous trouvez actuellement à l’endroit même de son intrigue, dans la province d’Almería, en Espagne. En effet, la fiction rejoint la réalité ! J’ai un amour fou pour ce lieu, où j’ai atterri pour la première fois en 2015, lors d’une résidence d’écriture. Une terre très étrange, encore bercée par le passage des Romains et des Phéniciens, il y a des milliers d’années. Et étonnante à explorer, notamment le désert de Tabernas où de très nombreux films ont été tournés et dont les paysages sont hantés par le cinéma. Une histoire culturelle très riche, qui me passionne tant qu’elle risque d’être aussi le cadre d’un second ouvrage.
Dans ce roman, on suit le périple de Vanina, en Andalousie. Une dame âgée, mordante, attendrissante et un brin excentrique. Une sorte d’al- ter ego ou au contraire tout droit sortie de votre imagination ? Elle est un concentré de femmes que j’ai observées dans ma vie personnelle et mon métier. Il s’agissait de créer une figure fantastique, sorte de sage parmi les sages, âgée de mille ans mais toujours aussi curieuse de l’existence. Je trouve le passage du temps fascinant. J’ai cinquante-trois ans et quelle richesse d’avoir derrière moi toutes ces aventures et expériences passées. C’est pourtant une période de la vie dont on a tendance à peu parler, surtout en matière de féminité et c’est l’un des thèmes prégnants de Rouge Western. J’ai grandi dans un milieu patriarcal et j’ai été en guerre contre ces inégalités depuis l’enfance. Jouer Les Monologues du Vagin d’Eve Ensler au théâtre a aussi représenté une véritable prise de conscience vis-à-vis ma propre histoire mais aussi à la vision que la société à du corps de la femme et au harcèlement et au sexisme que subissons trop souvent. J’ai voulu aborder ces questions difficiles en les mêlant à un univers solaire et léger, aux intrigues rappelant un western hollywoodien.
Ce séjour, organisé pour le grand anniversaire de Vanina se transforme en effet rapidement en périple initiatique, aux airs de vendetta. Quel est votre propre rapport au voyage, vous qui avez aussi publié Selfie de Chine, racontant vos quelques mois sur place ? Lorsque j’étais petite, nous logions un appartement dans le sud de l’Espagne. Lors de ces vacances, je côtoyais des enfants venant de nombreux pays et cela m’a donné le goût du voyage et le rêve de le vivre via mon métier. J’ai eu la chance de faire de nombreuses tournées théâtrales dans le monde et avoir gagné le prix de littérature de l’Union européenne en 2013 m’a permis de découvrir la Chine, les pays de l’Est et nombres de régions peu touristiques. C’est pour moi un puissant moteur de créativité.
De nouveaux voyages font-ils partie de vos projets pour les mois à venir ? En effet, je prépare pour le prochain Festival international de la littérature de Montréal une performance à partir de Rouge Western. Elle revêtira la forme d’une “sieste sonore”, créée avec la musicienne Sarah Espour et avec pour décor des œuvres du plasticien Marcel Berlanger. Il s’agira d’un patchwork de sons, musiques et voix à partir d’une adaptation du texte, que je jouerai sur scène. Et je suis également invitée à la Foire internationale du livre de Guadalajara, au Mexique, l’une les plus importantes d’Amérique latine. J’y représenterai la Belgique, via l’Union Européenne. Ce sera aussi l’occasion de réaliser une résidence à Mexico. Encore un très beau terrain d’exploration.
Y a-t-il un ou une artiste tous azimuts, qui vous inspire particulièrement ? La chanteuse espagnole Rosalía. C’est une artiste et une performeuse à l’univers incroyable. De même que j’étais une grande fan de David Bowie, qui m’a énormément influencée par son andr gynie et son art de la transformation. En tant qu’artiste et créatrice, ce qui m’intéresse est d’architecturer des mondes qui vont surprendre l’imaginaire du lecteur ou du spectateur. Et ainsi de l’embarquer vers un cinéma intérieur.
Lisette Lombé, à fleur de mots
Lisette Lombé, à fleur de mots
MOTS : BARBARA WESOLY
PHOTO : Amin Ben Driss
Intenses, ardents, sensibles, Lisette Lombé transpose les mots en porteurs d’un slam émancipé et en gardiens d’un engagement humaniste. Avec Eunice, celle qui a été nommée Poétesse Nationale pour l’année 2024, dédie sa plume à un ouvrage vibrant et libérateur.
Après avoir signé quatre autofictions, pourquoi avec Eunice, vous être tournée vers l’écriture d’un roman ? C’est un texte qui est né pendant le confinement. La scène était remplacée par des captations, sans public et l’observer a fait naître en moi de multiples interrogations, notamment sur le terreau féministe qui habite mon travail et la manière d’élargir cette base de partage qu’est l’écriture. Je me sentais alors un peu corsetée dans la forme très dense que revêt la poésie et je percevais que le moment était venu d’entrer dans le territoire de la prose et de la fiction. Il reste bien sûr une part d’intime qui construit l’histoire, notamment dans les relations mère-fille, qui me ramènent au lien avec la mienne comme avec mes enfants. Mais en écrivant, j’ai eu conscience de vivre un basculement jouissif vers ce moment où l’on cesse de parler de soi pour explorer un véritable univers de fiction.
L’un des personnages du roman déclare « Le slam, on n’y arrive jamais par hasard, c’est le slam qui nous choisit, au moment où nous avons le plus besoin de transformer nos émotions en poème ». C’est ce qui s’est passé pour vous ? Oui, totalement. J’étais au seuil du burnout lorsque j’ai découvert le slam. Je n’y connaissais rien. Mais en m’avançant face au public, avec un premier texte j’ai ressenti cette force qu’amène de mettre en mots des émotions parfois douloureuses, en recevant en retour une écoute pure et bienveillante. Dans la salle, se trouvait une metteuse en scène, qui m’a ensuite amené à participer aux Prix Paroles Urbaines, le plus grand concours de slam en Belgique francophone. C’est elle qui m’a fait découvrir la scène slam et ses codes.
La biographie qui accompagne votre site clame : « Pas de vie sans poésie. Pas de poésie sans engagement ». Se nourrit-elle, pour vous, forcément de lutte ? La poésie est un rapport au monde avant d’être une écriture. La capacité, malgré la noirceur, de perce- voir la beauté, mais aussi un langage imagé et sonore. A mes débuts, on m’a beaucoup associée à la colère, à l’élément du feu, certainement en raison de ma poésie dite sociale et engagée. Mais en parallèle à la dénonciation et la lutte contre l’invisibilisation de certaines injustices, l’excision ou le viol, parfois très durs et frontaux, il y a une forme de célébration, avec des textes joyeux, lyriques et rassembleurs.
Vous vous définissez également comme une passe-frontière. Quelles sont celles que vous souhaitez fissurer ? D’abord un cloisonnement de la poésie, que je combats en créant textes, performances, collages et livres. Et en l’amenant au-delà des lieux où elle s’exprime d’elle-même. Je me rends pour cela dans des lieux aussi différents que les prisons, les entreprises et les écoles. Et puis, à 45 ans, j’ai enfin l’impression d’arriver à une forme d’alignement avec moi-même, une réconciliation avec toutes mes identités. De ne plus avoir à choisir et donc exclure.
Que représente pour vous d’être nommée Poétesse nationale de l’année 2024 ? C’est une fierté. Ce n’est pas anodin dans le milieu poétique de mettre en avant une personne issue du milieu slam et donc de la poésie orale et engagée. Si l’objectif est de créer des ponts entre les langues et les terri- toires, il s’agit aussi de rêver ce rôle. Et pour moi, cela passera par un mot : « utile ». J’ai besoin de faire sens, tout comme c’était le cas dans mon métier d’enseignante, pratiqué pendant dix ans ou encore aujourd’hui, dans mes ateliers de slams. Avec notamment, une boîte à outils pour les professeurs mais aussi une petite malle poétique pour les enfants et de l’autodéfense par le langage créatif du côté des adolescents. J’aurai jusque mars 2026 pour dévelop- per ce lien pédagogique, qui a toujours été le cœur battant de mon travail.
Ce rôle vous laissera-t-il du temps pour des projets personnels ? Oui, l’on travaille, avec la musicienne Cloé du Trèfle, sur une lecture musicale d’Eunice. Nous avons vécu l’expérience de ce dialogue texte-musique lors d’une tournée d’une soixantaine de scènes, avec de superbes retours du public. Cela nous a donné l’énergie de faire perdurer l’aventure. L’album sortira le 6 octobre avant d’être à nouveau joué lors d’une vingtaine de dates.